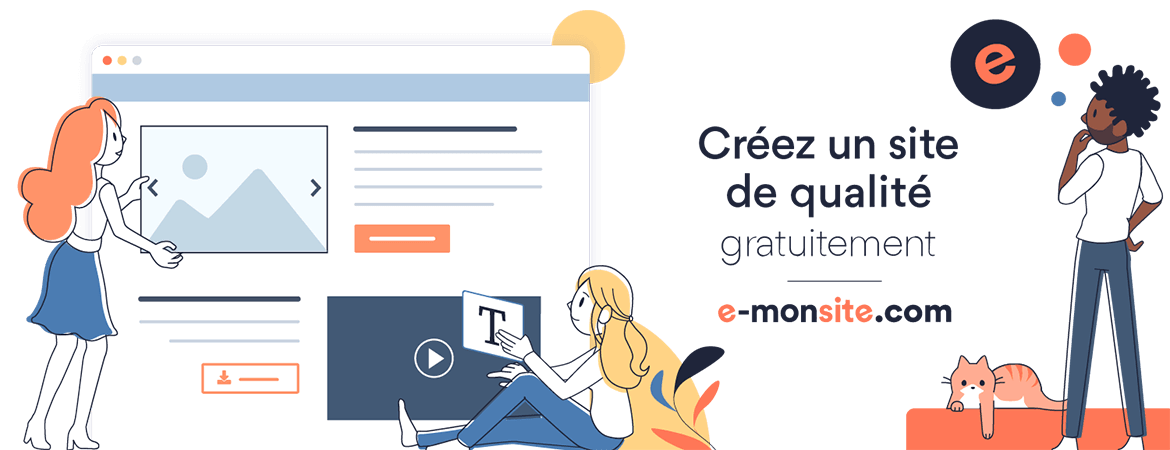Billets littéraires
L’éternité en moins, d’Antigone Trogadis
Je viens d’achever la lecture du beau livre d’Antigone Trogadis : L’éternité en moins. Un beau roman, écrit dans une langue superbe, un français qu’on aimerait lire plus souvent et qu’on ne rencontre que rarement… Un roman à la chronologie pas évidente, à la croisée du journal intime, rédigé par Rosa, Italienne ayant fui Rome pour Athènes, et du récit d’un retour au pays du jeune Manos, Ulysse moderne qui retrouve la capitale grecque, après sept ans d’exil à Montréal (où notre auteur est née). Le journal de Rosa est rédigé grâce au je narratif, qui nous rend bien plus proche et plus émouvant le personnage de Rosa, alors que le retour de Manos est lui tenu à distance par un il narratif. Manos n’en est pas moins soigné. On pressent que ces deux personnages finiront par se rencontrer… Ce beau roman est aussi douloureux : il parle de la Grèce de l’avant prise du pouvoir par les Colonels, un certain 21 avril 1967, et de celle qui, sept ans plus tard, voit la chute de cette criminelle junte et l’instauration si longtemps espérée de la démocratie. Moment dans le roman où Manos redécouvre Athènes et trouve une place dans journal (qui renvoie à un autre journal, celui de Rosa). Ces deux périodes — avant l’arrivée des tortionnaires qui ont éradiqué toute opposition, surtout communiste, puis après leur chute — plongent le lecteur dans un climat très délétère et inquiétant pour avril 67, et une ambiance toute aussi inquiète, légèrement vacillante, en 74, comme un accidenté réapprend à marcher après sept ans, cloué au lit. L’éternité en moins est donc un roman sur fond politique, dans un pays, la Grèce, qu’on dit avoir inventé la démocratie, mais qui n’a guère été démocratique depuis son indépendance, dont on sent, quand elle le devient, que la liberté retrouvée est et reste fragile… Roman sur fond politique donc, pas pour autant un roman politique, plus un roman sur l’âme de deux pays méditerranéens : l’Italie et la Grèce, vouées à la violence, aux spasmes d’une Histoire profondément tragique, hélas recommencée, un roman qui conclut qu’il ne reste pour toutes armes à Rosa que l’écriture de son Journal, Rosa n’ayant plus la force, écrit-elle dans un très pathétique aveu, « de faire rouler à nouveau le rocher qui finira, de toute manière, par retomber (comme celui de Sisyphe)… Mais pour Rosa, contrairement à lui, l’éternité en moins !
Editions N&B – 189 pages – 18 €
Pas de paix pour Paco !
Dans Aucune terre ne sera mienne, Sylvie Anahory a pris sa plus belle plume pour nous compter le destin de Paco, jeune paysan placé au séminaire de Jésuites à Huesca dans les années 1920-1930 en Espagne. Destiné à devenir prêtre, il ne pourra le devenir, autant par manque de vocation que par manque de foi. Quand éclate la Guerre Civile espagnole en 1936, il prend le parti des Républicains contre Franco et s’engage tout entier dans le combat, sachant que le froid, la faim, la mort sont déjà en embuscade. Mais Paco est valeureux, il épouse sa destinée comme d’autres obscurs qui ont fait l’Histoire. Autant dire d’emblée que ce récit (on a quelque mal à l’appeler « roman » même s’il en possède les qualités) — autant dire que ce récit est un beau récit, à l’écriture fière, droite, impeccable en somme, à l’instar du caractère bien trempé de Paco. Une écriture rude aussi, sans aucune concession, dont l’austérité sert le propos qui n’est pas léger…Des images poétiques, quoiqu’au bord de la rudesse, collant au contexte de l’époque et aux paysages. En lisant, j’ai pensé au film Padre padrone des frères Taviani qui se déroule, lui, en Sardaigne, pour une même rigueur dans le récit. Un récit solidement construit, reposant sur au moins trois narrations (j’ai cru discerner en filigrane une quatrième qui serait le point de vue de l’auteur ?) trois narrations donc qui se croisent, s’entrecroisent, l’une rédigée par le je narratif de Paco qui raconte sa geste par le biais de son journal intime, lu à des années de distance par son petit-fils François, petit-fils donnant du coup par sa présence une autre perspective et une profondeur nouvelle au livre. Au long de ces mémoires (ou de cette mémoire vivante), Paco nous restitue non seulement son enfance, son parcours, mais aussi ce qu’il voit et vit (c’est, à mon sens, ce qui fait la vraie force du livre) : l’année 1936 en Espagne et les trois années terribles qui suivirent, la guerre fratricide qui ensanglanta le pays et saigna une jeunesse prometteuse, les engagements des jeunes gens de cette génération, la lutte pour la liberté, l’exil jusqu’en France… Sans vraiment le sentir tout au long du récit, on pressent le gros travail sur les faits historiques qu’à dû faire l’auteur en amont de sa propre rédaction. Et, en arrière fond, comme une vague qui revient sans cesse, le fort leitmotiv de l’exil, qui devrait parler à tous et nous parle encore plus intimement aujourd’hui. On l’aura compris : Aucune terre ne sera mienne touche autant au cœur qu’à la mémoire de tous et ne peut laisser personne indifférent. A travers l’étrange destinée de Paco, c’est d’humaine condition dont nous parle Sylvie Anahory. On ne peut que l’en louer !
Mercredi 12 septembre 2018
Il n’y a pas de passé simple, de François-Henri Soulié
Pour avoir déjà rencontré François-Henri Soulié, je peux dire que son roman lui ressemble en bien des points. Vif, intelligent, spirituel, ne se prenant pas la tête, sans exclure la réflexion, la profondeur qui le caractérisent, dont bien sûr il se défend. A la suite de son héros, Skander Corsaro, journaliste au Courrier du Sud-Ouest, on s’embarque à la recherche d’un trésor dissimulé dans une abbaye cistercienne, intrigue d’où émerge entre autres une histoire de Résistance, aux heures sombres où les Juifs hélas étaient traqués par une police, la nôtre, à la solde de l’occupant… Skander est de ces héros qu’on aime sans barguigner : vivant seul avec son poisson rouge, ayant pour ami Tonio, pote qu’on aimerait avoir, et entretenant avec sa mère une sacrée complicité ; fana de moto, essentiellement les Morini, d’amours impossibles avec notamment la belle Sandra, morte depuis longtemps ; ayant sur la vie une avenante philosophie, qui vacille parfois entre bienveillance et vacherie… Dans Il n’y a pas de passé simple, il y a certes les atouts d’une enquête bien ficelée, menée au rythme de la Morini de Corsaro, mais aussi — surtout — nombreux personnages hauts en couleur comme Léo, le peintre, ou Chon-Chon, le vieux libraire. Des bons, des méchants, des fous, des salauds, des…j’en passe, bien évidemment, une galerie de savoureux portraits qui donnent au récit sa dimension humaine, trop humaine. On sait qu’il n’y a pas de bon récit sans une sarabande de personnages qui ouvrent le chemin de sa lecture. Je rajouterai qu’il faut un ton à ce récit. Et le ton Soulié est entraînant, empreint de malice, d’humour grinçant, de moult pirouettes et autres figures de style, rieuses, drôles et inventives. Je soupçonne son auteur d’avoir su renouer avec la veine des Gaston Leroux et autres Maurice Leblanc. Car il y a du Rouletabille dans ce roman, du Rocambole aussi, parfois à la limite du pastiche, un sourire narquois à la Umberto Eco… Etait-ce le projet de F-H Soulié ? Le connaissant un peu, il répondrait : « Ah oui ? Tu sais, je n’ai cherché qu’à m’amuser ! » Et sûrement amuser le lecteur. Pari gagné. J’ai adoré Il n’y a pas de passé simple. Skander fait désormais partie de mon olympe littéraire perso.
Mercredi 27 décembre 2017
Un cri silencieux, d’Amélie Lamiée
Il est des livres réellement habités, portés intimement par leurs auteurs et dont la retenue, l’extrême pudeur laissent deviner qu’ils sont pour ceux qui les écrivent une épreuve à franchir. Des livres en somme pétris par la chair de la vie. C’est justement le cas d’Un cri silencieux d’Amélie Lamiée, roman parue en juin 2016 aux Editions Fleur sauvage, que j’ai beaucoup aimé et dont j’ai dû attendre un certain temps pour en parler… Car c’est un beau premier roman, dont l’écriture serrée, la phrase maîtrisée et le ton juste donnent à penser qu’il sera suivi d’autres, tout aussi denses et forts. C’est ce qu’on souhaite à son auteur dont on comprend qu’elle a nourri cette première œuvre de ses propres secrets. Mais c’est aussi ce qui différencie une œuvre littéraire d’un livre formaté. Cela commence (un peu comme dans Rosemary’s baby) par l’installation d’un jeune couple et enfants dans une nouvelle maison. Une nuit, la salle de bains attire Mathilde d’où suintent, semble-t-il, les souffrances d’un passé douloureux. Est-ce celui de Mathilde ou celui de Camille, une enfant ayant habité la maison avant elle et dont Mathilde a découvert, sous une latte de plancher, ses carnets de Journal ? L’un renvoie-t-il à l’autre ou ces passés sont-ils liés par un même secret ? Au fil des pages, alternant entre la lente prise de conscience de Mathilde et les aveux livrés dans le Journal de Camille, l’auteur instille un climat savamment oppressant, menant progressivement le lecteur vers des révélations dont on ne peut parler ici… Le sujet abordé étant des plus sensibles, il exige donc une prose ramassée et une sincérité totale, qualités qui sont propres à l’auteur. On sort du livre un peu sonné, ayant partagé avec Amélie Lamiée un voyage envoûtant et poignant. Son cri est devenu roman. Qu’après ce premier livre, elle oublie le silence !
Dimanche 3 septembre 2017
Trois gouttes de sang et un nuage de coke et L’âge de l’héroïne de Quentin Mouron
Dans Trois gouttes de sang et un nuage de coke et dans L’âge de l’héroïne, Quentin Mouron est un auteur de polars jouant habilement avec les codes du genre noir. Mais il est un peu plus à mes yeux. Par le ton, l’esprit qu’il insuffle à ses deux romans (les seuls aujourd’hui publiés en France) cet auteur suisse, brillant, au style piquant et ironique nous parle de la bizarrerie d’être au monde. Avec Trois gouttes de sang et un nuage de coke, au-delà de l’intrigue qui se déroule dans une banlieue jouxtant Boston, le lecteur plonge dans un thriller proche du roman social, dont le mérite est de brosser la peinture sombre d’une Amérique monstrueuse, tétanisée par la crise des subprimes. Plus qu’en Europe encore (sans justifier ce qui se passe hélas chez nous), le monde des laissés-pour-compte américains nous est montré ici en dérive absolue. De terrifiants portraits qui font toucher du doigt ce qu’une crise financière et un système ultra-libéral peuvent causer de dégâts parmi les pauvres et ceux qui se retrouvent sans travail… Pas besoin d’un dessin : en quelques mots, tout semble ramassé et résumé sur les méfaits de l’horreur économique… Dans L’âge de l’héroïne, c’est autre chose : nous sommes dans le Nevada, décor grandiose et silencieux comme la mort, où l’on rencontre d’improbables personnages comme Léah, adolescente plutôt déglingue, qui croise la route de Franck, détective à ses heures et pas mal déjanté lui aussi. Léah va devenir sa dose de coke, avant de se changer en un bâton de dynamite incontrôlable. Pour la suite, au lecteur d’affronter ce drame au dilemme cornélien ! Ce roman-là est plus tranchant que le premier. Mais dans ces deux polars hors norme, précieux à double titre, à la prose bien léchée, il y a un style, unique, et une ambiance qui fait parfois penser à Un privé à Babylone de Richard Brautigan pour l’embardée absurde ou même, par sa liberté d’écriture, à La cité de verre de Paul Auster. Deux polars, cousus de fil noir, à l’ironie grinçante, omniprésente, sans être pour autant lassante. Elle pourrait dézinguer l’intrigue. Mais non : elle est constitutive de cette intrigue et reste probablement le personnage principal de ces deux livres. Brautigan et Auster : c’est dire la qualité et l’ambition dans laquelle évolue notre auteur. Quentin Mouron : un nom à retenir.
Mercredi 7 septembre 2016
Requiem pour une racaille, de Gil Graff
L’uchronie est un genre littéraire qui eut son heure de gloire dans la seconde moitié du XIXème siècle. L’auteure de Requiem pour une racaille a décidé de s’y coller. C’est tout à son honneur. Beaucoup pourraient être tentés de classer Gil Graff dans la famille des écrivains naturalistes. A tort. Ce serait mal la connaître. Avec ce Requiem… l’auteur nous fait entrer dans un cauchemar sans fin, où la condition humaine est décrite sans fard, sans once de complaisance, et confrontée au crime et à l’horreur, monde dans lequel se croisent des enfants, des géants, de petits et grands monstres, évoluant dans un monde fasciste où, pour peu qu’on soit du côté du manche, on a droit de vie et de mort sur tous les parasites, les éclopés, les faibles, les enfants qui vous tombent sous la main. Julien, jeune homme à la situation plus que précaire, a su jouer des coudes dans cet ordre nouveau et se placer auprès de Wint, exécutant du tout récent régime, sorte d’ogre sanguinaire, violent et amoral. Très vite, notre Julien fait ses premières gammes dans l’horrifique. Comme il veut s’en sortir à tout prix, ne plus être humilié et que Dieu en ce monde est bien mort, tout est permis pour lui. La nouvelle cité est en marche, déterminée à écraser tous ceux qui, par malheur, se dresseraient sur son chemin. Ces autres pourraient bien être Lenny, frère de Julien, et une jeune femme prénommée Victor, qui ont pu fuir un camp d’endoctrinement, duo à la Steinbeck où Lenny incarne le géant au cerveau limité protégeant sa nouvelle et fluette amie. L’un a la force physique, l’autre une tête bien faite et n’a ici rien d’une souris… En quelques pages, le lecteur est plongé dans une nuit au climat oppressant, où manger, vivre en sécurité, sauver sa peau est devenu problématique. L’auteur, sous le masque d’une conteuse n’hésitant pas à faire dans le grotesque et grimaçant, parfois à la manière d’un L.F Céline, nous trousse une terrifiante fable qui nous renvoie (encore plus aujourd’hui qu’à la sortie du livre) à une réalité qui hélas se dessine : l’arrivée des barbares par la force ou les urnes. Le frisson est palpable ; ça pourrait bien le faire, comme on dit aujourd’hui. La force littéraire de Requiem pour une racaille tient aux moyens allégoriques qu’emploie Gil Graf pour nous forcer à regarder comment s’installe, fonctionne le fascisme. Comment l’ignoble et l’inhumain se mettent en place. Mais nous restons dans le roman, entre conte et sotie. On n’est pas loin d’Alice, de Gulliver, parfois même du côté du récit sadien et du Perrault de Barbe bleue. C’est dans cette sarabande bouffonne, aux confins de l’horreur que s’exhale le discours politique, enchâssé dans l’histoire comme un venin qu’instilleraient les phrases de Requiem pour une racaille. Un immense bravo à l’auteur qui excelle dans les situations scabreuses, jamais gratuites, dans la peinture saignante et peut-être au couteau de l’horreur programmée, au long de cette sanguine à drôle de goût d’apocalypse.
Mercredi 22 juin 2016
Le chien arabe, polar de Benoît Séverac
Izards, vous avez dit Izards ? Avec Le chien arabe, Benoît Séverac situe son nouveau polar dans un quartier chaud de Toulouse, là où un dénommé Mohamed Merah a mal grandi… Quand on connaît le quartier des Izards, on sait qu’on a affaire à ce que les bons apôtres appellent en termes choisis un des quartiers perdus de la République. Ce jargon-là n’est pas celui de Séverac. Il décrit sans jambages et donc sans fioritures la vie de cette zone livrée aux trafiquants et aux malfrats. Trafics d’armes, de drogue, recels variés, violences faites aux femmes, voilà le lot de tous les jours où pauvreté, précarité ne riment plus avec égalité, ni même fraternité. Trois héroïnes, si l’on peut dire, vont tenter l’impossible et tirer le lecteur à leurs basques et ne plus le lâcher : Sergine, vétérinaire plutôt costaude, Decrest, une flic en pétard contre tout et surtout contre ses collègues mâles au machisme ordinaire, et Samia qui alerte Sergine sur un chien défoncé à coups de pied par la bande à Noureddine. Nourredine, un des frères de Samia, qui se trouve au chomdu et qui vit de trafics. Sergine — et le lecteur dans son sillage, découvre rapidement pourquoi le chien se meurt. Et pas que ça : un trafic incroyable qu’il vaut mieux taire ici. Autre chose que découvre Sergine : la famille de Samia a décidé de la marier de force et l’envoyée direct au bled… Oh là, où sommes-nous ? En France, aujourd’hui même ! On a beau le savoir que tout cela existe, il faut une plume sèche, distante comme celle de Séverac pour brosser un tableau édifiant des Izards, livrés aux mains d’apprentis terroristes, de religieux mafieux et de seconds couteaux prêts à toutes les violences. Le polar de Séverac est loin d’être violent. C’est la réalité qui est violente. Ce qu’il décrit c’est cette violence qui suinte et qui menace, toute prête à éclater ici ou bien ailleurs, partout, tant nous avons laissé se déliter les choses. Le fatum rôde dans ce polar sans concessions qui, à certains égards, nous fait penser à cette veine du néo-polar qui a fleuri chez nous dans les années 70. Une veine qui se voulait militante, politique, et qui dénonçait les lâchetés et les dérives de notre cher pays. C’est peut-être bien à ça qu’un polar doit servir. Le chien arabe est un livre courageux, qui ne flirte pas avec la complaisance mais pose tout au contraire les vraies questions auxquelles il faudra bien répondre un jour.
Mardi 15 juin 2016
Ainsi soit-il, de Christian Eychloma
Dès les premières pages, Christian Eychloma nous entraîne dans une fiction qui pourrait être réalité. Et c’est sans doute sur ce pourrait que repose tout œuvre de science-fiction ou d’anticipation. Genre hélas décrié, considéré souvent comme une littérature pour la jeunesse, la science-fiction a eu pourtant son heure de gloire dans les années 60 en Europe et aux USA et pour toute une génération, la mienne en l’occurrence. 2001, odyssée de l’espace, le fameux film de Kubrick, fut le point d’orgue de cet engouement. Depuis, comme le fut longtemps le roman d’aventures, la science-fiction semble boudée, laissant la place au polar ou roman de terroir. Dommage, car un roman comme Ainsi soit-il vaut le déplacement (interstellaire). L’histoire est claire, tendue, écrite dans un style soutenu, sans descriptions ou portraits superflus et surtout sans ce luxe de détails technico-scientifiques que l’on rencontre trop souvent dans ce genre de roman… En quelques phrases, l’auteur nous embarque sur Héphaïstos, planète qui abrite un bagne d’où personne ne revient. Là croupissent des opposants à un régime ayant régné sur Atlantis, planète-mère tombée entre les mains des militaires. On trouve parmi tous ces bagnards des scientifiques, déportés politiques mêlés à d’autres « droit communs ». Une révolte longuement préparée va les conduire à fuir Héphaïstos à bord d’un vaisseau retapé et, après maintes pérégrinations, les acculer à regagner l’ancienne Fédération où se trouve Atlantis. Mais le temps a passé. Qu’est devenue la planète Atlantis, sachant que le voyage, plus le temps passé au bagne d’Héphaïstos, se compte pour eux en Temps que je qualifierai de sidéral ?... L’hibernation à laquelle ils sont tenus de se soumettre dans leur vaisseau est l’occasion pour notre auteur d’apporter à l’intrigue un beau rebondissement. Arrivés enfin sur Atlantis, ils découvrent… On n’en dévoilera pas plus, sachant qu’un tel roman se découvre pas à pas et se goûte d’autant. Bourré d’idées, de théories sur le Temps et l’Espace inspirées de la théorie du grand Einstein, (je ne suis pas franchement scientifique pour avoir tout réellement compris), ce beau roman à au moins quatre dimensions nous fait toucher du doigt cette aventure qu’est l’existence humaine et pose de grandes questions sur notre devenir. A lire autant pour voyager dans l’espace infini que pour penser à l’évolution de l’espèce.
Vendredi 10 juin 2016
Vernon Subutex 1, de Virginie Despentes
J’ai toujours eu des réticences à lire les contemporains vivants primés ou glorifiés par les médias… Et pour Virginie Despentes (comme pour Houellebecq), j’ai dû attendre qu’on ne parle plus d’elle et que retombe la fièvre médiatique pour m’y coller. Trop de bruit à la sortie d’un livre, trop de tapage médiatique gâchent souvent sa découverte spontanée. Il est vrai qu’il y a deux ans, j’avais entendu Despentes (de la Croix-Rousse) parler de Subutex 1 aux Quais du Polar à Lyon et qu’ayant moi-même vécu dans cette bonne ville, je savais qu’elle y avait écrit Les chiennes savantes… Me plongeant dans Subutex 1, je n’ai pas été déçu. La vigueur du style, l’ampleur du propos et la multitude des personnages signifiants sont bien là. Drôle de nom que Subutex, mais on le comprend très vite pour peu qu’on cherche dans Google. Pour Vernon, on pense au pseudo de Boris Vian, Vernon Sullivan mais surtout au lacanien vers-non. Le pitch de Subutex 1 pourrait se résumer à l’errance d’un quinquagénaire déclassé en quête d’amis de jeunesse (que sont mes amis devenus), qu’il retrouve mariés, rangés, embringués dans des boulots peu reluisants ou des jobs de prédateurs, quand certains ne sont pas morts, n’ayant pu survivre à la vie d’artiste ou n’ayant pu supporter la gloire, ici musicale. A la rue se retrouve donc Vernon, suite à une dégringolade sociale programmée par le système puisque que son commerce – Subutex était disquaire – a fermé boutique. Le lecteur suit donc Vernon dans une odyssée qui le conduit d’un squat chez plusieurs ami(e)s à un divan provisoire chez un ancien pote pour garder un chien, quand il n’est pas disc-jockey un soir chez un trader maléfique, plutôt vérolé sur les bords… Des portraits, beaucoup de portraits, tous criants de vérité. Au gré de ses pérégrinations, Vernon doit affronter de pathétiques retrouvailles avec d’anciennes femmes qu’il a connues, qu’il ne reconnaît plus et qui elles-mêmes le trouve has been quand elles ne le jettent pas dehors. A la fin de cette première partie de Subutex, on retrouve Vernon faisant la manche et dans l’obligation de faire la queue à la soupe populaire. Il y a une intrigue dans ce récit, plutôt lâche, autour d’un ancien et renommé rocker que Subutex aurait enregistré juste avant sa mort et dont il détient, sous forme de bobines, une manière de testament, lequel serait recherché pourrait être négocié et que le magnifique personnage de La Hyène est censé récupérer… Mais ce n’est pas là l’essentiel du bouquin. Vernon Subutex offre, à la manière d’un La Bruyère, une série de portraits saisissants d’hommes et femmes en prise avec les questionnements, les drames et problématiques d’aujourd’hui. Des portraits sans concession, efficaces, taillés au diamant qui, mine de rien, donnent une vue en coupe d’une étrange et fabuleuse galerie de caractères propres à notre époque. S’il n’y avait que ça ! Il y a plus. Moi qui suit un fan de Céline, j’ai cru reconnaître en Virginie la petite nièce de notre imprécateur des Lettres, y compris – surtout - quand sa prose devient ouvertement et franchement politique… Avec Subutex, elle renoue avec une veine drue, une vision du monde abrupte et saine qui traverse l’histoire littéraire depuis Rabelais. Pour ce Subutex-là (je vais me ruer sur le deuxième en attente du troisième), je salue bien bas une grande dame des Lettres qui nous parle de la vraie vie, du dérèglement du monde qui pèse sur nos pauvres vies et détruit ce qui nous fait tenir encore debout et flageolant comme Subutex.
Dimanche 15 mai 2016
Maltalents, de Jésus Manuel Vargas
Un nouveau Jésus Manuel Vargas est toujours attendu avec fièvre. Son tout dernier opus, Maltalents, vient juste de sortir. L’écrivain qu’on connaît, qui cache sous des paroles et un rire bienveillants, acuité du regard et sens de la formule, a su une fois de plus nous concocter un cocktail incendiaire dont il a le secret. Sans l’air de vouloir y toucher, il joue en virtuose sur plusieurs cordes littéraires avec œillades marquées au cinéma qu’il chérit tant. Ce roman-là a donc deux fées penchées sur son berceau : Littérature et Cinéma. Ainsi, pourra-t-on dire qu’il y a de la Guerre des Etoiles, du Seigneur des Anneaux, de l’Iliade certes aussi et autres gestes héroïques dans Maltalents. De l’épopée, du grand cinoche, on le répète (Vargas nous fait son cinéma, mais en 3D), de la chanson de geste et autres chants guerriers. Forme oubliée que la chanson de geste que ressuscite un Vargas affûté, dont le texte tendu restitue les faits d’armes accomplis, les prouesses physiques, les luttes merveilleuses contre des monstres et des forces maléfiques d’une incroyable armée formée pour conquérir et pour tuer. Je dirais même aussi : pour créer des histoires. Et c’est là que l’auteur nous fait passer à travers le miroir, lieu idéal pour écrire un roman et inventer des mythes. Des histoires ? Maltalents en regorge ! Venons donc justement à son pitch : un couple, le narrateur-écrivain et sa compagne Gloria, s’installe dans une maison qu’ils doivent faire leur (on pense à Rosemary’s baby). Parallèlement, on entre dans l’histoire qu’écrit le narrateur. Il y est raconté l’histoire d’un jeune garçon qui, ayant fui la cadre familial éclaté en morceaux, se retrouve hébergé dans un lieu très bizarre : La Pépinière, institut où sont recueillis de jeunes sans-familles pour suivre une rééducation en règle. Là officie le Professeur Fungi (réminiscence des Fungi de Yuggoth de Lovecraft ?), Fungi donc, maître-penseur faisant froid dans le dos. D’autres formateurs (du verbe formater) sont là pour conditionner ce jeune monde qui ne demande qu’à apprendre et surtout à grandir dans tous les sens du terme : deux maîtres es-guerre, le Colonel Stone et le Sergent Peebles (encore le cinéma, Oliver et Kubrick de Full Metal Jacket ?). Un ami de galère, Le Chien, prend sous son aile le narrateur et l’accompagne à la division de Manipulation des Masses où ils sont affectés. Tout un programme dont on assiste au déroulé. Pas triste : carnages sanglants, cyniques, sans le moindre état d’âme. Mais Vargas nous la joue grandissime, avec une perfide et maléfique habileté dans l’agencement du récit, alternant les scènes domestiques du couple, et horreurs de la guerre, étripages et autres règlements de compte entre condisciples de la Pépinière qui s’entretuent pour cause de Brise rouge. Il faut bien sûr voir là une métaphore de notre triste monde mais vu peut-être à travers les rêves d’un gamin, s’imaginant en Superman voulant sauver la Veuve et l’Orphelin et dont, l’âge mûr venu, les espérances ont fait un fantastique flop. La Brise Rouge est-elle une maladie ou simplement un mal de vivre ? Qui peut le dire ? L’auteur ô combien inspiré ? Evidemment, ces récits angoissants de bruit et de fureur sont émaillés miraculeusement par quelques réflexions senties sur l’écriture, avec entre autres une qui paraît évidente à Vargas : il nous faut raconter inlassablement des histoires, les raconter aux autres et à soi-même, sachant que la chanson de geste est celle que nous faisons et choisissons, que nous restons les artisans de nos propres destinées et qu’un bouquin comme Maltalents, écrit de main de maître, préfigure on le sait, d’autres histoires à venir. Merci, monsieur Vargas ! Nous ne pouvons décidément avoir de maltalent à votre égard !
Mercredi 15 juillet 2015
Les rats
C’est ma concierge, Mme Bouzige, qui m’avait alerté la première. « Vous avez vu ces rats qui courent dans l’escalier et qui sortent par dizaines par les bouches d’égouts ? Je n’en ai jamais vu autant depuis la guerre ! Il faudrait voir à en parler aux services de la Ville ! » Ce qui fut fait dans les jours qui suivirent. Une équipe arriva. De grands et forts gaillards envahirent le quartier, dératisant en quelques jours les cours d’immeuble, les caves et les greniers. J’appris par les journaux qu’une même opération avait été organisée à l’échelle nationale, avec tous les moyens pour exterminer cette vermine. Les rats ! Personne ne savait trop d’où ils venaient. La chose qui était sûre, c’est qu’ils grouillaient ! Mais très rapidement on soupçonna qui en était le principal vecteur : les innombrables embarcations chargées de clandestins qui échouaient sur nos rivages. On installa sur les points névralgiques des Centres où tous les arrivants étaient contraints de se doucher et de passer devant un médecin qui décrétait sa quarantaine. Mesure d’hygiène élémentaire. Total et unanime était le consensus. C’est juste après que tout a basculé. Mme Bouzige dut m’en parler mais je n’y pris pas garde. Les mêmes costauds, venus dératiser nos rues et nos immeubles, s’en prirent aux prétendus vecteurs de l’invasion ratière et les reconduisirent dans des bateaux pour qu’ils retournent au diable. Il y eut, ici et là, quelques protestations, vite étouffées par les antiennes de la consommation. J’avoue n’avoir rien dit. Mme Bouzige qui, elle, avait connu la guerre, ne voyait pas les choses d’un bon œil. « Tout ça ne sent pas bon ! me confia-t-elle. Si la situation empire, ils trouveront des responsables de partout ! Moi, vous, que sais-je ? ». — Mme Bouzige, nous sommes en république ! — Plus pour longtemps ! Je conviens aujourd’hui que j’ai été aveugle. Ou lâche, ce qui est pire. Le pouvoir se durcit. Eliminer les rats, les émigrants ne réglait pas les choses. Il fut dès lors question de ceux qui n’avaient pas d’emploi, de citoyens dont l’utilité n’était pas évidente, comme les artistes, les écrivains... et de tous ceux qui avaient protesté contre les reconduites à la frontière. Et tous furent enfermés dans les Centres pour migrants, privés de leur famille et de leur liberté. Là, je dois dire, ça me donna un sacré coup. Mme Bouzige me dit que la prochaine fois serait pour elle. — Mais comment ça ? De quelle prochaine fois... — Ils disent à la télé qu’à la place des concierges, ils mettront des mouchards ! Deux jours plus tard, ils embarquèrent Mme Bouzige. Je cherchai à la retenir mais je reçus un coup de matraque qui me sonna. Quand arriva le tour des Pleutres, des Indécis et des Indifférents, je fus du lot. Dans le camion qui transportait notre incrédulité mêlée de peur, je demandai : — Et que font-ils des Indifférents ? — Ils ne s’en soucient pas et les laissent crever dans leur coin ! A tout prendre, mieux vaut être tué par eux ! Je n’envie pas ta fin ! Moi, l’indécis, j’ai peut-être une chance de rejoindre leur cause ! Au Centre, j’ai retrouvé Mme Bouzige qui avait bien maigri. Elle m’a à peine reconnu. Puis on nous a poussés dans une chambrée où s’entassaient des ombres. C’est là que j’en ai vu un, puis deux, puis des dizaines se faufiler entre les lits. Des rats, des centaines de rats courant tout excités et attendant bien patiemment qu’on s’affaiblisse pour nous manger.
Vendredi 27 mars 2015
En attendant Godot, par l’Avant Théâtre* de Villepinte
Beau moment de théâtre que cette représentation d’En attendant Godot présentée par L’Avant Théâtre ce 7 mars 2015 à Villepinte dans l’Aude, avec quatre comédiens à la hauteur d’un texte pas forcément facile et réputé casse-gueule. Longtemps considéré comme un auteur distant, Samuel Beckett ne fut pas toujours compris de son vivant, au point d’être monté dans des mises en scène lugubres, tant on craignait de trahir le maître... Résultat : on s’ennuyait souvent à ces spectacles. On découvre aujourd’hui que Beckett est un auteur très drôle (comme on le constata avec Kafka), même si ces deux auteurs ont aussi et d’abord une fibre tragique. Paul Dussel, metteur en scène et comédien jouant le rôle de Vladimir, a su saisir l’angle drolatique, burlesque et même clownesque de Beckett. Du coup, tout est vif, enlevé, chaplinesque dans ce spectacle qui a su retourner aux sources où s’est nourri Beckett : le music-hall, le cirque, le cinéma muet. Gilbert Peyre, dans le rôle d’Estragon, Paul Dussel dans celui de Vladimir incarnent, comme l’a voulu Beckett, l’auguste et le clown blanc de l’interrogation existentielle. Tous deux sont d’une précision parfaite dans leurs mimiques, leur jeu de scène sans cesse renouvelé et inventif, sachant communiquer l’extrême plaisir qu’ils ont à jouer leur duo. Dans un décor minimaliste — un arbre rabougri, deux sacs que trimballent nos drôles de vagabonds, ils disent attendre Godot, mais on comprend qu’ils cherchent un sens à l’existence, qu’en attendant il faut bien vivre, passer le temps, se divertir, comme aurait dit Pascal. Justement leur arrivent Pozzo (Stéphane Saouma, physique et diablement présent) et son porteur Lucky (Nicolas Reichel, proprement saisissant), autre couple déjanté qui se partagent les rôles de maître et serviteur. Cet intermède étrange, où les rapports humains sont mis à mal, permet à Vladimir et Estragon d’attendre le lendemain et d’accepter le rendez-vous avec Godot mille fois ajourné. Durant tout le spectacle, on rit beaucoup face aux situations déconcertantes servies par les quatre comédiens, même si on sait que le fond de la pièce parle de la condition humaine. Bravo encore aux comédiens pour leur intense prestation ! En attendant (Godot ?), ayant passé une excellente soirée avec ces quatre comédiens, souhaitons-leur tout le succès que leur spectacle mérite !
* L’Avant Théâtre, Villepinte — 11150
Lundi 9 mars 2015
Coupure d’électricité, de MCDem
Je ne connaissais pas Murielle Compère-Demarcy. Elle signe (sous l’abrégé MCDèm à la manière d’un graff sur les murs de la nuit) un long poème Coupure d’électricité aux Editions du Port d’Attache. En présentant ce beau poème-fleuve, son préfacier cite la Beat-Génération avec pour haute lignée celle de Rimbaud et celle d’Apollinaire. Il faudrait ajouter à ces F—du logis poétique la prose syncopée du grand Cendrars, oublié trop souvent, prose que MCDèm partage et déroule brillamment. Quand je dis prose, c’est manière de parler. Court tout au long de cet épique poème urbain une musique de fond, un staccato de sons sortis du désordre du monde, — de notre monde à la technologie hypertrophiée, où la F—Electricité décide de faire grève, créant un chaos d’envergure, entre autres ferroviaire, puisque les voies du Sens sont emmêlées, ce qui, comme en écho, rejoint l’in-tranquille phrasé de La prose du Transsibérien... Dans ce torrent de mots hâtifs, catapultés, jetés comme des jets de peinture sur 3 mètres sur 3 tels les rescapés d’un monde fou, un fusible a sauté dans la tête-à-poèmes de l’auteur. Tant mieux ! Sans cette coupure, pas de rupture, et donc pas de poème. La scansion de Coupure d’électricité fait très souvent penser à un halètement, à une course folle, un parcours balisé où le poète se cogne. Un chœur de voix intimes qui nous suggère que la poésie est de chair, que le poète doit marcher, inventant par là même son chemin de lumière, loin des canons de l’Art dit officiel... qu’une coupure peut sectionner aussi les nerfs de la raison. La nuit a enfanté sa rouge calligraphie. Eurydice et Orphée peuvent bien se rhabiller. Quant à Narcisse...le miroir a déteint. Nul doute : la sarabande de MCDèm rappelle l’équipée rimbaldienne, la mélancolie visionnaire de Guillaume, le festin nu de Burroughs et Ginsberg... Coupure d’électricité devrait être dit à voix haute comme un mantra chargé de sortilèges.
Coupure d'électricité, Editions du Port d'Attache, 2,50 €
Vendredi 6 mars 2015
O Gwendoline !
Gwendoline m’avait dit adieu. Sa voix avait changé, son dos aussi où avait poussé une bosse... Peut-être que Gwendoline avait toujours été bossue... Je n’en ai plus le souvenir... Peut-être même que notre amour n’avait été qu’un rêve... Tant pis ! Une fois parti, j’ai pleuré moi aussi. Fini la douceur de l’étreinte ! Adieu nos rites de lectures ! Morte l’amour de mon aimée ! Je ne regrettais rien, oh non ! Le monde m’attendait. Marchant par les chemins, je croyais voir se profiler ma gloire future. Au soleil, me disais-je, tout semble aller de soi. Mais sous la pluie ou dans le vent glacial de nos régions ? C’est à cet instant-là que j’ai commencé à boiter. Que tout s’est déréglé en somme. La nuit tombée, j’ai décidé de m’enfoncer dans les bosquets. Je savourai l’humus du sous-bois. Tout près d’un feu, je rassasiais ma faim et, en pensant à Gwendoline, je lui jouai un air de mandoline. Puis, m’enroulant dans un lainage que mon amie avait tissé pour moi, je m’endormis. Dans mon sommeil apparurent deux yeux rouges. Un loup. Je sortis une lame que je plantai entre ces braises. Du sang jaillit. Surgit alors ma tendre Gwendoline, la robe sanguinolente. « Qu’as-tu fait là ? » me criait-elle. Je cherchais à m’enfuir mais je ne pus que m’éloigner très lentement, tirant une patte derrière moi. « Sois donc maudit ! » vomit une harpie qui possédait le corps de mon amie. Je m’élançai sur elle. Une douleur me traversa le flanc. En me tirant la bourse, les deux voleurs, entrés dans le sous-bois, avaient cru bon m’occire. Je tâtonnais autour de moi, cherchant des yeux ma mandoline. Je me levai, pour m’écrouler presque aussitôt. Sous mon poids une corde vibra, prélude à ma mort imminente qui n’aurait pas eu lieu si j’avais caressé la bosse de Gwendoline.
Microfiction - Lundi 16 février 2015
Le chien d’un immortel suivi par le chef de dieu * de Lionel Mazari
Un nouveau Mazari ? Vite, ouvrons-le ! On n’est jamais déçu avec un tel auteur ! C’est un poète, un vrai ! D’emblée, si l’on s’en tient à ce qu’il veut bien nous dire en postface, Le chien d’un immortel... serait un journal rédigé en attendant la fin du monde, bouteille au néant jetée destinée à n’être lue par personne puisque tout sera à jamais consommé. Heureusement, Armageddon n’a pas eu lieu ! Ce qui nous laisse le champ libre pour lire cette chronique poétique, méditation autour du souvenir et d’un présent dont l’essentiel — toujours selon notre poète — se situerait sur les toits de Marseille ! La facétie, l’apache clin d’œil font partie intégrante du poète. Il serait vain de s’en tenir à ses allégations modestes : dans D’après la mort, il avait prévenu : « Les choses sérieuses, je ne les fais que seul». Seul est sans doute beaucoup dire ici : ils sont peut-être deux dans Le chien d’un immortel... : celui qui dort et l’Autre (je est un autre) qui a profité du sommeil du premier. Ce journal, même si Lionel Mazari l’écrit l’œil rivé sur les toits de sa ville, est une réflexion - coutumière à l’auteur — sur les pouvoirs du poète sur le monde, sur l’action lente, profonde d’une poésie qui modifie soi et le monde. Une réflexion baudelairienne. Mais là, la plume entaille plus profond la chair du monde. La méditation sur de micro événements qu’il a pu observer, mêlés à des résurgences du passé, crée l’acte poétique. Il semble que Mazari ici fasse une pause : oh, certes, il reste toujours aussi vivace, raide, exigent et bien sûr in-tranquille ! Tant par les thèmes abordés que par les fulgurances ciselées, on n’est bien sûr pas loin de L’impossible séjour, même si les différents poèmes sont en prose rythmée. On y rencontre au fil des lignes (j’en ai déjà parlé mais y reviens) une sorte de dédoublement où le dormeur (des toits ?) feint de céder la place à un fantôme, « quelqu’un s’est inquiété de mon bonheur pour y rêver »... Et le chef de dieu dans tout ça ? Un oncle qui respirait « au large dans le néant facile ». Un dieu sans majuscule. Pan est-il préférable ? Toute la finesse du poète nous souffle que même nos souvenirs peuvent devenir présents si nous ne cessons pas de nous les remémorer (D’après la mort), que le réel est affaire de rêve éveillé ou de simple dormance. Alors rôde dans ces poèmes drus et purs l’âme d’un chien, compagnon on le sait du poète, son double en somme penché sur son épaule pour arracher « à l’os... [...du monde] ...quelques morceaux d’étoiles ». Lire Lionel Mazari redonne envie de lire notre bas monde avec des yeux lavés par une pluie « qui s’envole des bras ouverts de l’arbre humain ». Merci à lui ! Sa voix est essentielle. Qu’il n’oublie pas de se « cogner au ciel » pour le bonheur et la plus grande élévation de ses lecteurs !
*Editions du Port d’attache – 6 euros
Mercredi 22 octobre 2014
Viva Modiano !
Ne boudons pas notre plaisir : un prix Nobel de Littérature français, voilà qui nous rappelle nos heures de gloire ! En toute honnêteté, j’attendais Philip Roth ou Milan Kundera. Ah, Kundera, voilà qui aurait eu une certaine gueule ! Patrick Modiano est certes une franche et belle surprise. L’auteur que nous avons tous découvert, d’abord grâce à Pivot, alors le pape d’Apostrophes sur le petit écran, nous présentait alors sa Place de l’étoile, son premier livre. Autant était-il emprunté, confus dans son élocution, autant sa plume filait, errait dans les rues de Paris à la recherche d’un parent ou d’un ami perdu...se cognant à des portes cochères ou entrant dans des cours intérieures improbables, parlant aux inconnus d’un jour qu’elle ne reverrait pas, à la manière d’un K lâché en liberté. Depuis, des noms trouvés dans le bottin (à l’instar du grand Simenon) ont été à l’origine de maints personnages aux passés obscurs — car pour Modiano, rien n’est simple, nous avons tous connu des gens ayant eu plusieurs vies, donc plusieurs passés — des ombres ayant parfois changé d’identité, des silhouettes louches ayant frayé avec des collabos... bref tout un monde interlope, pas toujours net sur lui, surgissant d’un passé plutôt noir, celui de notre histoire française : l’Occupation. Peu à peu, Modiano, avec sa légendaire timidité, avec cette simplicité qui n’appartient qu’à lui, avec ses tics de visage et ses mains recherchant l’arabesque parlante a bonnement construit une œuvre, nourrie sur le terreau de nos non-dits. Car c’est précisément de quoi il est question pour Modiano : dire le non-dit, ou en tout cas le suggérer, tenter de l’approcher et de l’amadouer. Toute vie devient alors une énigme à résoudre. Un des jurés du prix Nobel a parlé d’un « Proust d’aujourd’hui » au sujet de Modiano. Moi, je le verrais plus du côté de Kafka, errant dans le dédale d’une vie où rien n’est fiable, où tout est bon pour s’égarer, où même quand on retrouve la trace d’un père parti au bout de la nuit, ce qu’on apprend de lui reste fragmentaire, voire illusoire, donc angoissant. La dernière interview de notre prix Nobel de Littérature est bien sûr savoureuse. Il n’a rien perdu de ses doutes et hésitations langagières. Il est resté le même et quand on lui demande ce qu’il compte faire après ce prix, eh bien, dit-il, continuer... enfin... euh... oui... à écrire !
Mercredi 15 octobre 2014
Personne ne parlera de nous lorsque nous serons morts de Gil Graff
Gil Graff, connue pour être un auteur de polars, prouve qu’elle a, avec son dernier opus, plus d’une corde à son arc. Rien n’est plus frustrant que d’être cantonné dans un genre, qu’il soit littéraire ou autre... Avec Personne ne parlera de nous... elle nous livre une belle et forte fresque qui retrace les grands moments de l’histoire de la Catalogne du nord. Roman ambitieux qui traverse le XXème siècle, englobant la Guerre d’Espagne, la Retirada, le Camp de Rivesaltes, la Seconde Guerre mondiale, jusqu’ aux élections calamiteuses de 2002... Dès le début du roman, Rémo et Maria, un couple de vieux attendrissants et décalés, ouvrent magistralement le livre. Rémo seul le fermera. Entre l’ouverture et l’épilogue, se déploie dans tout le livre sur une soixantaine d’années une curieuse complicité entre ces deux, faite de tendre connivence, de camaraderie dans le combat et d’humour haut en couleur, voire décapant. Arrivé très jeune à Perpignan le superbe Rémo va vivre de ses charmes, puis se mettre en ménage avec une gueule cassé, Victor. Chemin faisant, il rencontre Maria, aide-soignante qui, très vite, l’entraîne dans son activité militante à la Miranda, maison qui accueille des femmes fuyant la guerre d’Espagne. Morceau de bravoure qui nous montre l’afflux des réfugiées qu’il faut bien soigner et aider à accoucher, passage réussi — comme celui qui traite des inondations ou celui, poignant, de l’incendie — qui pourrait s’apparenter aux Désastres de la guerre de Goya. Car Personne ne parlera de nous... est une fresque noire qui parle des Invisibles, (nom donné aux homos dans l’entre deux guerres), des obscurs, des laissés pour compte, des sans grades, de ces anonymes qui ont œuvré secrètement durant cette tragique période pour sauver ce qui restait encore d’humain dans l’Homme. Gil Graff réussit haut la main son pari plutôt risqué, car rien n’est plus casse-gueule que de tenir les rênes d’un roman choral. Elle les a en mains, dans une langue drue, précise, brassant avec un certain brio la vie de ses personnages qui nous accompagnent longtemps après avoir refermé le livre. Au jeune SDF Olivier, qui veut à la fin du livre transcrire l’histoire de la Miranda, Rémo — sans être assuré qu’une « telle histoire soit dans l’air du temps » — lui conseille de « raconter la vie tout nue, toute crue ». On pourrait répondre à Rémo : mission accomplie pour ce qui concerne la fidélité à la vérité. Pour le reste, on peut rassurer l’auteur : on se fout complètement de l’air du temps !
Samedi 9 août 2014
Missives du vent d’Henri-Michel Polvan
On croit savoir où se situe le Ponant. Mais le Polvan ? Non, ce n’est pas un pôle (ou alors le pôle Sud), ni même un vent (le mistral pourrait faire l’affaire). Non, le Polvan est une langue haute, noble, splendide, émaillé de camées et d’émaux comme dirait Théophile, qui à la fois sent la garrigue, nous plonge dans l’ombre d’une gorge, nous montre un ciel semé d’étoiles où logent les poètes, ces vagabonds aux cœurs et aux semelles de vent. La Grande Ourse nous regarde. Nous avançons sur le grand Chemin de la vie pareil au Bateau ivre. On rit — car Polvan n’oublie pas qu’il faut être léger ; on s’émeut, laissant choir son menton, pensant que le soleil est bien trop chaud pour entamer sa promenade. L’anisette n’est pas loin. Et on reprend ces discursives Missives en écoutant vrombir le taon. Un lézard passe, traversant la tonnelle. Quand on est bon lecteur, on comprend vite que notre auteur a bu aux rondes mamelles surréalistes mais ce serait ranger ce franc-tireur sous une bannière qui ne peut être que réductrice. Le visiteur si attentif de Malrieu est un poète à la prose charnelle, envoûtante, goûteuse, pleine de pleins et de déliés, tranquille, mimant la joie quand il s’agit de gravité, qui porte son lecteur vers des territoires collineux où errent les âmes de Char, Apollinaire, Breton, Soupault, Desnos et quelques autres... Terres d’élection qui exigent la rigueur de l’amour comme la faiblesse de l’amitié, la lame des déconvenues, la gouge de l’espoir. Dans ces lettres malicieuses, adressées à un tu que l’on sent proche du poète (qui n’est peut-être que lui-même ou un autre poète) s’inventent des métamorphoses au creux de chaque ligne. Henri-Michel Polvan est magicien du verbe et il sait bien que ses missives ne sont pas aussi minces qu’il paraît le prétendre, même si elles parodient parfois Les lettres de mon moulin. Notre Midi est là, solaire, avec un ciel vibrant, débarrassé des lucioles de la nuit où s’ébroue le passage du Temps, traînant dans son sillage des pépites de sens d’où naît la poésie, cette tension entre deux paroxysmes : la Mort et la Beauté. La Mort, n’en parlons pas ou en couplets diaphanes. Parlons de la beauté qui parcourt ces Missives du vent, cousus de mots diaprés, ô combien délicats, piochés dans la besace des Illuminations.
Jeudi 10 avril 2014
Pourquoi le Testament des Muses n’a pu avoir le prix Goncourt
Les gars et dames du Goncourt, installés chez Drouant, m’ont appelé au téléphone. Tous se sont excusés de n’avoir pu défendre mon roman. C’est Pivot qui était embêté. Plus que moi. Lui, il voulait passer à table. Pas moi. Edmonde cherchait un siège pour s’asseoir. La littérature, passé un âge canonique, est épuisante. Généralement, dans ce métier, on termine membre d’un jury de prix, on n’écrit plus ou peu. Moi aussi. J’ai cru que tous avaient botté en touche, pensant que j’aurai droit au Renaudot. Pas du tout. Ce n’est pas moi, c’est Moix qui a été choisi ! J’aurai dû préparer un discours, peut-être qu’ils se seraient senti contraints de lire au moins Le testament des Muses. Mais non ! C’est vrai que pour le lire, il lui aurait fallu être sélectionné. Encore que. Je me demande qui lit dans un jury, qui ne lit pas. Il y a toujours des tire-au-culs, même en littérature. Comme moi. Non mais, sans rire : pour être sélectionné, il faut avoir pignon sur rue chez un grand éditeur. Moi, je suis à la rue ! (Pour le Pignon, voir Un dîner de cons) Bref, juste après le palmarès, ils n’aspiraient qu’à déjeuner. Moi non. Ils avaient oublié de m’inviter ! J’ai pensé leur envoyer un courrier bien senti pour leur apprendre à respecter les convenances. J’ai laissé braire. Goncourt et Renaudot m’avaient, une fois de plus, fait faux bond. Tant pis. L’année prochaine, même si on me supplie, je bouderai la grande bouffe de chez Drouant !
Jeudi 7 novembre 2013
Conseils à un jeune écrivain
L’été en pente douce donne au vieux scribe que je suis l’envie de m’adonner à l’art de distiller quelques conseils aux écrivains en herbe. Je ne sais si cet exercice doit être qualifié de cuistre ou simplement d’utile. Ce que je sais, c’est que lorsqu’on fait ses premiers pas dans la forêt des Belles-Lettres, personne n’est là pour vous guider dans l’équipée dorée mais rude qu’est l’écriture. C’est peut-être mieux ainsi car si, par aventure, on apprenait qu’on en a pour la vie, on regarderait à deux fois. Heureusement, on ne sait rien ! Les dieux de l’écriture font bien les choses... Mais revenons à mon propos. Pour première règle, j’inciterai notre écrivain pubère à voyager. Loin, sans confort, seul de préférence. Voyager de la sorte est la manière la plus pratique d’apprendre la solitude. Il en aura besoin quand il prendra la plume. Je recommanderai ensuite à notre débutant de vivre sans entraves, de n’accorder aucune valeur à la vie matérielle, de chercher le dérèglement, l’enivrement, de vivre à mille à l’heure, de se frotter sans peur à l’écorce du monde. L’excès finit par rendre sage. Puis je l’inviterai à se calmer, ayant engrangé mille vies potentielles et l’assujettirai à une règle d’acier : rigueur en toutes choses, d’autant quand on écrit. Surtout si on écrit ! Ne comptera pour l’écrivain nouveau que la scansion des mots et leur arrangement, les nuits blanches et les jours couleur encre, les mots étant fœtus avant d’être bébés poussant leurs premiers cris. L’écrivain débutant se méfiera de la gente importante, des puissants qui veulent faire son bonheur pour mieux l’amadouer. Il devra être féroce et se montrer intransigeant avec ceux qui battent les cartes dans la République des Lettres. Qu’il ne transige pas, il tomberait dans la facilité ! Et qu’il écoute plutôt le doux chant des sirènes de l’insatisfaction, du doute, de la fragilité d’un texte, même quand ce texte est bien tenu et qu’il ravit, séduit, enivre la compagne des jours sans pain. Pour ultime conseil, je le convierai à s’établir à la campagne, sachant qu’il s’ennuiera très vite et que du coup il écrira !
Mercredi 21 août 2013
De la notoriété
Je suis toujours frappé de voir combien de comédiens, de musiciens, de sportifs, d’écrivains ayant atteint une certaine notoriété sont ignorés par ceux pour qui la comédie, la musique, le sport ou la littérature ont si peu d’importance. Un nom connu dans tel ou tel domaine ne l’est que lorsqu’on s’intéresse au monde auquel il appartient. Autrement dit la notoriété est toujours relative, souvent vaine et parfois illusoire. Tel roi, nous dit Montaigne, connu pour ses exploits sous telles latitudes, passait pour inconnu sous d’autres cieux. La mythologie des Anciens chantait les aventures des héros et des dieux, que l’on fêtait et honorait. Aujourd’hui, évoquer leurs prouesses n’a aucune chance d’être entendu. Chacun recherche, dirait Warhol, l’instant magique où il apparaîtra sur un écran et connaîtra son heure de gloire. Notoriété certes fugace mais à l’image d’une notoriété plus établie, qui chasse l’une pour être elle-même chassée à tout jamais sur les tabloïdes de l’Oubli. Cruel destin que de vouloir absolument briller et vouloir être vu, admiré, suivi comme un modèle ou comme un phare de la pensée, et retomber très vite dans l’anonymat. J’ai connu de bons écrivains qui se vendaient très bien de leur vivant et dont on a oublié jusqu’à leur nom. Leurs bouquins même, dont on vantait la qualité, sont introuvables. Pourtant leur lectorat fut grand. Je soupçonne même leurs meilleurs lecteurs de les avoir « zappés » une fois pour toutes de leur mémoire. Si ce n’est pas misère que l’inconstance humaine ! Tel musicien qu’on regardait comme un génie vivant, tel comédien qui emplissait les théâtres à Paris, tel sportif qui déplaçait les foules dans les stades ont eu lauriers et gloire, nul ne le nie. Mais plus personne jamais n’en parle ! Ou enfin si : dans les livres d’Histoire. L’ultime reconnaissance se tapirait-elle donc dans les manuels scolaires ? Mais il y a plus fort : il en est d’autres – et c’est je crois l’apothéose de la notoriété – qui gagnent leurs galons parce qu’ils sont morts et parce qu’un engouement soudain les tire d’un purgatoire obscur. Les voilà donc (re)connus. Tant mieux ! Mais pourquoi diable de leur vivant ne furent-ils pas portés au firmament de la reconnaissance ? Mystère... Il en va donc de la notoriété comme du vent qui souffle souvent sans rimes ni raison. La Belle Otero qui avait été adorée, comblée par ces messieurs du Tout-Paris mourut à quatre-vingt dix sept ans dans l’oubli absolu. Il est vrai que ses admirateurs fervents étaient morts avant elle, que plus personne en ce bas-monde ne savait plus qui elle était !
Mercredi 31juillet 2013
Vers l’horizon d’Hélène Loasis
Peut-on guérir de ses blessures d’enfance, de ses blessures tout court ? Tous ceux qu’on a croisés jadis étaient-ils ceux que l’on imaginait ? Nous-mêmes n’étions-nous pas enviés pour notre vie qu’on détestait ? Peut-on écrire ce que furent nos souffrances ? Est-on sorti d’affaire quand enfin on les nomme et se peut-il qu’on marche enfin vers l’horizon ? Il y a dans le dernier opus d’Hélène Loasis – Vers l’horizon - toutes ces questions qui se bousculent, profondes, meurtries, encore à vif et qui n’ont pas toujours la plus petite réponse. Ecrire ne serait donc que clarifier une fois pour toutes ce que l’on fut, que dénoncer ses errements pour mieux les circonscrire ou les réduire, comme on dirait d’une fracture. Justement, parlons-en. Vers l’horizon parle de fractures, de déchirures, de hontes bues, de drames familiaux qu’on pense deviner et qui restent un secret, connus de celle seule qui fut petite fille mais qui, écrivain aujourd’hui, se joue tranquillement de nous. Les vrais secrets ne peuvent être divulgués. Même et surtout quand on est écrivain. L’autofiction n’est pas dans les cordes d’Hélène Loasis. Tant mieux ! L’écriture comme unique salut, c’est peut-être bien en fait le vrai sujet du livre. Dans son recueil précédent, L’ombre des jours, on avait assisté à ce qui ressemblait à une cérémonie des adieux destinée à inhumer les dernières meurtrissures d’une enfance perdue, les derniers cris poussés contre la Sainte Famille. Ici, on y revient mais avec moins d’enjeux comme si on avait dépassé un cap, que notre narratrice sortait enfin du cauchemar que furent ces jours anciens où vivre était un véritable enfer. Filtrent parfois au coin d’une phrase les éblouissements d’instants fugaces, la drôlerie d’une gamine dressée pour être triste. Il y eut celui qui, d’un regard, sut la tirer du gouffre où elle était tombée, l’ami à qui elle reste à tout jamais reconnaissante. L’ombre a laissé la place à une aube naissante. La narratrice veut désormais « courir vers l’horizon où le soleil, timidement, pointait ». On peut penser que délestée de son fardeau - trop lourd pour elle, elle pourra s’envoler dans l’azur et déployer ses ailes d’écrivain accompli, elle qui fut albatros moqué et agacé, dit Baudelaire, par les hommes d’équipage. Sa prose intransigeante vaut le détour, ses démons sont les nôtres. Vers l’horizon trace une voie nouvelle, une perspective dégagée où, on le sent, s’égailleront bientôt les moi multiples de l’auteur que l’on attend au coin du bois. Personnellement, j’adore attendre. Pas trop longtemps, sinon je mords ! En attendant, mordons à belles dents dans ce nouvel opus d’une revenante !
Vers l’Horizon, Hélène Loasis, Editions Publibook – 15 euros
Jeudi 25 juillet 2013
L’ombre des jours d’Hélène Loasis
Après lecture, j’ai mis du temps à me défaire de cette Ombre des jours. C’était un signe, car ce recueil m’a bouleversé. J’ai dû attendre pour écrire ce billet d’être un peu libéré du tremblé de ses phrases. Lire L’ombre des jours, c’est être confronté à un combat que s’est livré il y a longtemps l’auteur avec elle-même. Et ce combat, c’était oser se vivre libre, vaincre ces peurs que chacun peut connaître, qui nous contraignent à ne plus être et à gommer ce qui en nous est singulier. Sous l’égide sartrienne, - je m’avance peut-être - ce recueil de textes parle d’une métamorphose, celle de l’auteur qui a compris qu’on est ce que l’on fait de soi ou qu’on devient ce que l’on est, comme dirait Nietzsche. Encore faut-il être averti que notre liberté se gagne, quand il ne faut pas l’arracher à mains nues. Il faut entrer dans ce recueil de textes denses, secrets, empreints d’enfance et de mystères comme on pénètre dans une forêt de signes où chaque mot a son pesant d’humanité souffrante. Ces textes brefs, qu’on devine nourris d’expériences vécues, trouvent bien sûr une résonnance en nous. Comment pourrait-il en être autrement ? Impitoyables quand ils dénoncent les faux-semblants, les habitudes, la violence de la vie, le rapport homme-femme, ils peuvent être ironiques, voire franchement comiques quand il s’agit d’épingler un repas entre amis autour d’un barbecue. Le malaise n’est pas loin quand on touche à l’os de la souffrance, même si on sait que l’écriture recrée le souvenir en l’amplifiant ou en réglant ses comptes à de vieilles douleurs... Il y a cette ombre qui appelle la lumière, qu’on voit filtrer parfois derrière les mots, timidement et sans éclat. L’œuvre qui suit, on le comprend, ressemblera à un ciel clair, plus dégagé, après que notre auteur aura posé un point final à ce recueil. En attendant, il faut continuer à vivre avec plus de lucidité, plus de légèreté peut-être, sachant que l’oasis n’est jamais loin. L’oasis, c’est le lieu où on pose son bagage après un long périple, l’oued où l’on se désaltère qui est ici celui - toujours recommencé - de notre enfance perdue. Parmi ces textes, on trouve dans Vacance, je crois, l’évocation du temps retrouvé, ce qui nous fait entrer en résonance avec l’auteur de la Recherche, en partie par les thèmes qu’aborde en mosaïque Hélène Loasis mais aussi, et surtout, par le déroulé de ses phrases. Elles ont été polies avant d’être formées sur le papier, roulées mille fois sur la langue de l’auteur comme les cailloux de Démosthène avant qu’Hélène Loasis accepte de les lâcher. Je parlerai d’envoûtement à leur propos. Oui, somme toute, L’ombre des jours ressemble à un rituel chamanique censé exorciser tous les démons, ceux de l’auteur comme les nôtres. Laissez-vous envoûter : c’est tout le mal que je souhaite à ses futurs lecteurs.
L’ombre des jours, d’Hélène Loasis, Editions Publibook – 16 euros
Mercredi 22 mai 2013
Les tribulations de Stephy J., de Stéphanie Jaeger
Nouvelle surprise dans ma pioche du mois ! Après Vargas, voilà Stéphanie Jaeger ! Perpignan serait-il devenu le nombril du monde littéraire ? On pourrait le penser... Dans ses Tribulations de Stephy J., Stéphanie Jaeger nous livre une chronique très actuelle, pas triste d’une jeune divorcée en charge de deux jumeaux, bien décidée à mener tout de front : sa carrière, ses amours, l’éducation de ses bambins... En femme libre, elle nous raconte - sous forme de chroniques rythmées comme ses journées menées à donf - ses ennuis, ses emmerdes, ses hauts et bas, ses états d’âme, son existence en fait au jour le jour (voire minutée) en quête de sens. Ce journal de bord d’une femme d’aujourd’hui est vif, pétillant, rapide et plein d’allant. Souvent impitoyable, il ne s’embarrasse pas de circonlocutions pour dire son fait à la gente masculine et à la gente humaine tout court. Car derrière ce ton enlevé, léger, drôle, agaçant - parfois comme un bonbon acidulé, se cachent des sentiments profonds, une réflexion sur ce qu’est vivre dans le monde d’aujourd’hui quand on est une jeune quadra et qu’on doit affronter, même juchée sur des talons aiguilles, la vulgarité de ce monde. Sous des airs enjoués et faussement frivoles, Stéphanie Jaeger n’est pas une « gentille » comme on pourrait le croire. Non pas qu’elle soit méchante, mais on sent bien que sous son look de jeune battante se niche une moraliste qui regarde notre époque sous le verre grossissant de la satire sociale. Si elle regarde les hommes sans guère de concessions, elle ne se ménage pas non plus et sait jouer de l’autodérision. Elle sait aussi parfois montrer que sous ses fringues chics bat un cœur tendre, qui sait aimer sans tomber dans le mièvre ou la facilité. « On peut, nous dit aussi Stephy au tournant d’une phrase, avoir l’air futile et se poser de vraies questions ». Ces tribulations trépidantes – tribulations du latin tribulatio qui signifie aussi tourment – nous narrent au sens propre les aventures d’une jeune fonceuse où il ne manque ni les épreuves, ni les tristesses, ni même les petits bonheurs de l’écriture qu’on croise ici et là sous la plume acérée de Stéphanie Jaeger. Au fait, Stephy existe. Je l’ai même rencontrée ! On dit qu’elle a monté sa maison d’édition. Bigre, voilà bien son courage ! J’attends donc avec impatience le volet II de l’odyssée moderne de Stephy F. qui, m’a-t-on dit, ne devrait plus tarder !
Les tribulations de Stephy J., de Stéphanie Jaeger. Editions LTSJ
Vendredi 10 mai 2013
Avec une dernière dose d’enthousiasme, de Jésus Manuel Vargas
Dans son dernier opus, Jésus Manuel Vargas a encore frappé. A moins qu’il ne s’agisse d’un esprit frappeur, mais ça nous l’apprendrons plus tard... Dans Avec une dernière dose d’enthousiasme, le narrateur nous parle d’un lieu qu’on ne peut dévoiler au lecteur. Disons qu’on le découvrira accidentellement... Attachons-nous au narrateur, jumeau craché de celui de Pénélope andalouse, en moins speed, plus posé si j’ose dire, qui ne court plus faire ses adieux à sa grand-mère mais dit adieu à ce qui fut un jour l’aimable confrérie de ses amis, ces proches qu’on aimait tant, qu’un jour on ne reconnaît plus, soit parce qu’ils ont simplement changé, soit parce que c’est nous qui ne sommes plus les mêmes. Cette fois, Vargas y va piano, use d’une plume à fleuret moucheté pour nous parler du temps qui passe, de la fidélité (ou non) à nos promesses adolescentes, de la vie, de la mort, d’un barbecue où l’on comprend au fil du récit qu’on finira tous cendres après que l’on ait avalé patiemment les dernières doses d’enthousiasme qui nous restaient. Tous les vivants fêtant l’anniversaire du narrateur sont édifiants : Bertrand, Gustave, Joachim, Cassandra – ah, Cassandra ! – et la tristesse même qu’est Béatrice, tous parlent vrai et d’un itinéraire pas toujours évident où s’entrecroisent les illusions et les espoirs d’une génération perdue. Beau texte grave, nimbé d’un humour décalé, où notre narrateur pour avancer coche des cases, jouant comme qui dirait à la marelle de la vie. Poignante confession en fait à laquelle le lecteur est convié, prenant part malgré lui à ce grand déballage de l’âme, à un bilan sans concession que semblent faire tous les amis, le narrateur en tête. Beau livre où erre une nostalgie poignante et où s’étoile la certitude qu’on ne « réussit » pas sa vie mais qu’on la vit avec pour seules compagnes d’équipée des femmes fières, aimantes et libres, et pour complices des flasques de whisky (la vodka n’étant pas répudiée pour autant). Dans Pénélope andalouse, Jésus Manuel Vargas saluait son enfance et retournait à ses racines avec l’allure d’un jeune Rimbaud en mal de poésie. Là, on croirait qu’il s’est arrêté à Harrar et qu’il tourne une page pour faire en somme le point sur son parcours perso. Mais pour autant qu’il n’arrête pas d’écrire : on attend son troisième avec la boulimie vorace de l’alligator - boulimie qui anime tout lecteur véritable.
Jeudi 2 mai 2013
Pénélope andalouse, de Jésus Manuel Vargas
Ah, de petits miracles arrivent quelquefois ! De ces épiphanies qui rendent la vie légère et disons supportable. Un livre peut faire l’affaire. C’est rare, mais ça arrive. La preuve : lisez Pénélope andalouse. Belle et racée tenue s’émane de ce bouquin. Son auteur : Jésus Manuel Vargas qui sait boxer sa prose comme personne. Il la torée peut-être, allez savoir ! En tout cas, il ne lâche rien, bataille et fonce comme le taureau. Quand on entre dans son livre, on pense d’abord à un semblant de road movie mais que l’auteur ferait avec lui-même. Quand on poursuit, on sait qu’il faudra s’accrocher, qu’aucune concession ne sera faite. Nous voilà donc sur les hauteurs. Tant mieux ! C’est un peu âpre, violent – quoique voilé par la tendresse qui se profile ici ou là... Parfait ! La phrase swingue et coule bien. On sait bien sûr que le ciseau a dû couper dans la graisse du texte... C’est le fatum de l’écrivain. Une cigarette, relaxe-toi ! Los Atochares où notre narrateur débarque en début de récit devient un lieu mythique tout comme Adra, transfigurés comme de juste. Loin de la France, pour cause de retour aux sources sous les auspices de la Mort, il écrit malgré tout, tient un journal de bord. L’hôpital espagnol, c’est un peu comme l’auberge. Tu y apportes ta vie, en miettes ou non. Chambre 328 : une cigarette, relaxe-toi ! Bref, la vie n’est pas simple. C’est ce bouillonnement de mort et d’existence qui semble l’apanage du narrateur-auteur. Mais cette effervescence à fleur de mots finit par devenir la nôtre en fin de compte, embringués malgré nous dans ce voyage initiatique au ton antique. Dans Pénélope andalouse, il y a aussi du Mama a cent ans de Carlos Saura. Toute cette famille qui passe, repasse, ces parents éloignés qui viennent visiter l’ancêtre, Pénélope qui se meurt. Et qui attend. Même pas peur de la mort, Pénélope ! Elle veut revoir tous ceux qu’elle aime. A commencer par « le petit Français » qui n’est autre que le narrateur, cahotant entre deux mondes, fumant pour s’enivrer comme Baudelaire, se trempant dans la vie – la vraie vie – jetant dans des carnets des choses vues, des carnets qu’il relit et rature, encore, toujours, jamais content. Il y a du sang au coin des mots, des silences – il n’aime pas trop parler le narrateur, ce que je crois. Parler est subsidiaire quand on écrit - ou trop grossier. L’Andalousie enfin – qui est peut-être la véritable Pénélope attendant ses enfants égarés comme Ulysse - pousse ses cornes dans cette prose. Il y a dans ce Pénélope andalouse des fulgurances à la Lorca, un frère de sang probablement... Le road movie tourne au romancero. Cette cérémonie des adieux se clôt sur la découverte d’une valise, ferment d’où naîtra l’écriture avec ses aléas, ses doutes et ses jubilations. Il manquera toujours deux pages au texte jamais fini ! Bref, vous m’aurez compris (ai-je pris la fièvre du narrateur ?) : il faut lire sans délai Jésus Manuel Vargas. Courez, volez et payez cash son bougre-livre ! Vous ne pourrez être déçu !
Pénélope andalouse, Jésus Manuel Vargas. Les Presses littéraires.
Vendredi 26 avril 2013
Franz Kafka, arpenteur virtuose
Il y a longtemps que je voulais rendre visite à l’ami Franz Kafka. J’ai passé tant de nuits à le lire qu’il valait bien un bonjour fraternel. C’est fait. J’ai vu à l’ombre du grand château de Prague, la ruelle d’or où il logea durant trois ans. J’ai préféré ne pas traîner dans le cimetière juif où il repose car j’aurais cru alors que Kafka était mort. Absurde, non ? Je n’ai pas plus été tenté par une visite au musée éponyme. On m’aurait dit qu’on le gardait bien chaudement dans de la naphtaline ! Le connaissant plus rieur qu’on ne dit, car il avait beaucoup d’humour (mélange d’humour juif mâtiné d’humour tchèque), il aurait épinglé le-bureaucrate-musée. Non, je voulais sentir sa ville et suivre dans le dédale de ses rues l’ombre de Joseph K. Kafka m’a certes hanté longtemps, non tant par ses romans (Le Château, Le Procès, L’Amérique...) que par ce qui apparaît à fleur de peau - il faudrait dire à fleur d’âme – dans son fameux Journal. Tout est dit sur ce qu’il endura et sur la complexion de sa personne. L’écorché vif qu’il fut, le solitaire penché sur son grand œuvre reste pour moi la référence littéraire par la tension qu’il met dans ses nouvelles souvent inachevées, par sa patience de grand coureur de fond dans ses romans ; les déambulations de K dans Le Château et de Joseph K. dans Le Procès sont exemplaires. Nous tous cherchons de même une issue à la vie. Pas d’issue, nous dit K. Nous sommes cernés par la bêtise, la tyrannie, le vice, la vaine gentillesse de nos sinistres concitoyens. Ou par l’Etat, la Loi, les Dogmes, la sainte Famille – et Franz parlait bien sûr en connaissance de cause. Dans Le Château, cela tourne au cauchemar. Pour parvenir à joindre les Messieurs, c’est tout un drame. Une bonne centaine de pages ne suffisent pas ! C’est un peu l’impossible arrivée ou encore : l’impossible odyssée. Ce qu’Homère pouvait se permettre en plongeant l’industrieux Ulysse dans moult aventures, Kafka ne le peut plus. Déjà avec Quichotte, Cervantès sentait bien que ce qui nourrissait la grande littérature était le vent dans les moulins, que son héros avait trop lu de livres pour vivre une vie réelle et qu’une prostituée avait pour lui les charmes d’une noble dame. Avec Kafka, l’espace du réel n’est plus fiable du tout. Adieu Balzac ! Atteindre le château, c’est être confronté à pleins de chausse-trappes, à des semblants d’humains qui exécutent des ordres venus d’En haut, à des malentendus multiples qui rendent caduques toutes relations humaines normales. Dans Le Procès, la course de Joseph K devient poignante car elle ressemble à celle d’un rat dans un absurde labyrinthe. La mort heureusement le frappe ce qui soulage K. Fin d’un moment crucial dans la littérature mondiale. Après Kafka, le monde ne sera plus le même. Il rejoindra la barbarie de la Colonie pénitentiaire vingt ans après la mort de l’écrivain, quand il ne tombera pas sous la domination du gigantisme de l’Amérique. L’Amérique : roman drôle, chaplinesque de Kafka qui est, à mon avis, l’un des plus tendres qu’il ait écrits.
Lundi 24 septembre 2012
A propos d’Une visite chez Jean Malrieu d’Henri-Michel Polvan
La visite au grand écrivain – ici au grand poète qu’est Jean Malrieu - est un genre aujourd’hui oublié. A croire qu’il n’y a plus ni grand poète ni visiteur en quête de quintessence poétique... Avec Henri-Michel Polvan dans Une visite chez Jean Malrieu, on n’est pas loin du genre. Il y a pourtant un mais : Polvan vient en ami, en compagnon de route qui a suivi l’itinéraire tant politique que poétique de Malrieu, non en admirateur faisant ses premières gammes. Donc nous est épargné le texte hagiographique qui trop souvent hélas tient au genre. Ici, rien de tout ça et c’est bonheur. En poète qu’il est, Polvan nous parle d’un frère, d’un météore qui, ayant rencontré Breton, s’est quelque peu brûlé les ailes à l’aune du réel et de la dialectique. L’engagement n’a pas toujours bien inspiré les grands poètes. Qu’importe ! Polvan dans sa Visite invite son lecteur à pénétrer dans l’univers limpide et lumineux du maître sur la pointe des pieds. A petites touches, nous nous asseyons près de lui, lisons sur son épaule, écoutons s’égrener la Poésie en mots. Les maux ne sont pas loin. Et tout ce qu’une génération a dû bon gré mal gré avaler comme couleuvres ! Certains y ont laissé leur âme (je pense à Aragon), d’autres ont su prendre la tangente, dont Malrieu. Chemin faisant, à la lecture d’Une visite...on s’initie aux mystères poétiques, aux pièges de l’Histoire, à ce qui reste après tous les combats qu’on a menés emplis de rêves et d’illusions. Ce qui nous reste, c’est justement cette indomptable réflexion que la poésie mène sur le monde, cet obstiné chemin de feu qu’elle ouvre pour combler nos béances et nous guérir de nos insuffisances. Polvan, grâce à l’étroite intimité qu’il a avec Jean Malrieu, nous donne l’occasion d’être en lévitation totale le temps de savourer de merveilleuses formules comme « nous avons le sens épique du bonheur » ou ce beau vers qui clame : « J’attends l’amour comme la foudre et les voleurs de grands chemins ». L’hommage rendu n’est jamais ampoulé, pesant, dithyrambique. Il est critique, confraternel et amical, sans jamais être complaisant. On aimerait bien sûr connaître d’autres extraits de pages de correspondance entre Malrieu et Polvan. Mais ce sera sans doute l’objet d’un autre essai...
Lundi 6 août 2012
Signature
Dans le petit monde des Lettres, l’auteur ne peut échapper à d’étranges rituels. Celui notamment de la signature du livre qui vient de sortir en librairie et qu’il faut accompagner pour qu’il fasse son chemin. Curieux exercice en fait que de rencontrer lecteur ou lectrice futurs. Il y a ceux qui passent et qui repassent, sans oser s’arrêter. D’autres qui vous guettent du coin de l’œil, livre ouvert entre les mains, entre deux rayons. Ceux qui se détournent, pensant - à raison peut-être - que l’auteur se prostitue en vendant ses livres. Il y a ceux qui viennent flairer le livre, en lire un extrait avant de s’en séparer sans un seul regard pour le malheureux auteur. Une signature est une rencontre entre deux timidités : celle du lecteur que l’auteur perçoit et qui est du coup lui-même intimidé par l’extrême réserve de son lecteur. En fait, c’est une sorte d’intimité qui se tisse entre ces deux, chacun partageant un même amour de la lecture, car il n’y a pas d’auteur qui n’ait été – ou ne soit encore – lecteur. Je dirais même que l’auteur serait la forme accomplie du lectorat et qu’il ne chercherait bien qu’à rendre hommage au lecteur qu’il fut, entre huit-douze ans. Donc, une alchimie se crée, et la certitude partagée d’atteindre le domaine du rêve ou de la rêverie grâce aux mots écrits, porteurs d’une totale et infinie félicité. Quand l’auteur signe son ouvrage, il y a du mage en lui qui donne une clé secrète à son lecteur, sans même échanger un mot parfois. Un sésame muet, censé entrouvrir enfin la caverne d’Ali Baba au nouvel et tout friand adepte. Ce n’est pas signal cabalistique, mais ça y ressemble ! Mais il y a aussi de belles rencontres, bien rondes, bien goûteuses comme je sais les apprécier : ainsi, avant-hier, est apparue, là devant moi, une charmante octogénaire, fraîche, espiègle, l’œil plein de malice, (j’ai pensé à la délicieuse Maud dans Harold et Maud), m’assurant que bien qu’elle ne fêtât jamais Noël – un bon point pour elle – elle voulait « marquer le coup » auprès de son Claude d’époux, éternel lecteur qui gardait le chien, mais avec une dédicace « humoristique » et en l’incluant aussi (« Je m’appelle Monique, on m’appelle Moon »). Un bonheur ! Je me suis exécuté avec délices, tâchant d’être à la hauteur. N’empêche, grâce à l’elfe de toujours qu’était Moon (« car je le lirais aussi » m’a-t-elle promis) j’eus le sentiment de n’avoir pas perdu mon temps ni ma journée. Mon après-midi en fut illuminé quoique n’ayant signé que six ouvrages !
Lundi 12 décembre 2011
Tout près du paradis
Avec Aux alentours du paradis, recueil de douze nouvelles paru chez Edilivre, Jacques Lucchesi nous livre en filigrane un florilège de petites morts, qu’elles soient tragiques ou foncièrement comiques. On entre à petits pas dans ce recueil, sans bruit et sans fracas, ce qui laisse augurer le meilleur. Et l’on n’est pas déçu ! Du village provençal où il fait si bon vivre puisqu’on y a chassé la mort dans un enchantement de conte de fée au jeuTéléréalité où il sera question d’une autre mort, amoureuse celle-là, tout en passant sagacement d’une dimension à l’autre, le nouvelliste gambade à travers les collines, main en visière et contemplant d’un œil vif la garrigue, quand il ne saute pas dans l’abîme du Temps à la recherche de l’adolescent qu’il était et peut-être du vieillard qu’il finira par devenir un jour. Comme le chantait Brassens, les joyeuses pompes funèbres sont là pour rappeler, si besoin il y avait, que notre finitude n’est pas tragique puisque la mort elle-même est, elle aussi, risible. Jacques Lucchesi écrit bref et serré, ce qui donne à sa prose densité et vigueur. Son inventivité se trouve nichée dans l’angle où il aborde ses thèmes, - je parlerai d’angle rentré, et rien ne laisse présager qu’il nous mène par le nez. Il est du Sud sans conteste, car sa prose est limpide. Et, si l’on n’y prend garde, elle fraie avec les mythes qu’elle revisite à sa façon. Car dans ces douze nouvelles (comme le nombre d’apôtres, mais où est donc la traîtresse ?), on y parle de soleil, de saut dans l’avenir (ou de retour dans le passé), et le fatum qui surplombe maints récits - même s’il se trouve en embuscade – a la couleur de mer à marée basse. Quand je parlais de petits pas, en fait c’est notre auteur qui donne son allure, même quand parfois il nous entraîne vers un pas de travers. C’est justement dans cet infime écart que réside l’art du nouvelliste. L’époque est brocardée comme il se doit, technologie rimant avec monotonie. Dans tous les cas, on se convainc sans mal que Jacques Lucchesi devrait s’adonner plus à la nouvelle. Quant au lecteur, il ne saurait bouder un tel recueil : il est tout près du paradis !
Mardi 13 septembre 2011
Une curiosité littéraire : Lettres à ses amies-enfants, de Lewis Carroll
Le Pasteur Dodgson, ayant pris pour nom de plume Lewis Carroll, était un curieux bonhomme. Ses Lettres qui s’adressent à des enfants entre cinq et douze ans forment la matrice du plus singulier chef d’œuvre de la littérature mondiale : Alice au Pays des Merveilles. Pour le moins, notre révérend était étrange. Il était frappé du syndrome de Peter Pan, à savoir qu’il s’était arrêté mentalement (et sans doute physiquement) au stade de l’enfance, au point de n’en plus pouvoir sortir. D’où ces Lettres, qui sont mille baisers lancés à ses correspondantes - de vilaines petites canailles, qui fourmillent de calembours, de rébus, d’histoires abracadabrantes, de fausses pistes, de canulars, facéties en tous genres où notre pasteur est déjà surréaliste et bien avant l’heure ancêtre de l’Oulipo. On pense à ce fera plus tard Raymond Roussel dans son fameux et toujours obscur Comment j’ai écrit mes livres. Mais avec le révérend, il y a un mais : son goût prononcé pour les petites filles et sa tendre inclination pour la photographie (de nus de nymphettes) font de lui une sorte de Martien génial dans une Angleterre guindée, corsetée, traquant les mauvaises mœurs, perfide et somme toute victorienne dont Wilde sera la victime emblématique quelques décennies plus tard. Carroll - par quels stratagèmes ou tours de passe-passe ? – sut mener sa barque (il aimait le canotage) sans avoir été jamais mis sur la sellette. Etait-ce son statut de révérend qui déminait les ragots et absolvait ses frasques ? Peut-être. Mais il y a mieux : c’est avec l’accord des mères des petites filles – les petites Dora, Dolly, May, Alice...- que Lewis entretint toutes ses correspondances ou reçut chez lui ces gamines de cinq à dix ans pour faire des photos. Incroyable, pourrait-on croire, mais vrai de chez vrai ! Quand les gamines ont douze ans et plus, les mères s’y opposent, ce dont se moque Carroll puisqu’il les préfère plus jeunes. Quand, pour des raisons qu’on peut comprendre, il ne fait plus dans le nu photographique, (beaucoup de ces nus seront détruits par lui) il crayonne, s’adonne au dessin mais sans grand talent. Ses Lettres ont l’aplomb et la sérénité d’un esthète des petites filles. Mais aussi la ruse du vieil oncle raconteur d’histoires qui sait alpaguer son auditoire en mettant en scène un chapelier croisant une belette ou un lapin. Rien ne dit que le pasteur soit passé aux actes, excepté un seul baiser quand son jeune modèle sur le départ prend congé de lui. C’est sur ce fragile terreau d’enfance inassouvie, d’inguérissable nostalgie du giron maternel (devenu un terrier) que vont naître Alice, De l'autre côté du miroir et la fameuse Chasse au Snark. Là, dans ces œuvres, la liberté de Carroll est totale, jouissive, transgressive, loin du réel normatif. Ce qu’il ne peut connaître dans la vraie vie – mais le veut-il seulement ou n’est-ce que fantasmes ? – il le vivra psychédéliquement, sans peur d’être épinglé par les rumeurs ou les oukases de la Morale. Alice elle-même s’est affranchie des « pitoyables redondances du vaste monde ». Comment ne pas la suivre ou la laisser se perdre dans le dédale des pitreries de Sir Carroll ? Pour tout dire, je conseille vivement ces Lettres à ses amies-enfants (Aubier-Flammarion, édition bilingue) qui donnent de Carroll le meilleur angle pour l’aborder « en vrai » et qui, de loin, valent toutes les exégèses de la terre !
Lundi 11 juillet 2011
Il faut aimer Emma !
Parmi les ombres tutélaires des personnages de romans qui nous poursuivent après lecture, Madame Bovary est de celles sur qui achoppe longtemps notre adhésion. Nous avons bien du mal à nous identifier à elle, la jugeant bien naïve, pour ne pas dire idiote. Flaubert en est bien sûr le seul coupable, l’ordonnateur malin de cet étrange scrupule à accepter Emma dans l’ordre souvent injuste de nos affections littéraires. Le bougre est dans une telle détestation du genre humain qu’il nous donne en pâture, à travers le portrait d’une jeune fille d’autrefois, les dérisoires et assassins travers de la bourgeoisie de l’époque. Une bourgeoisie certes provinciale, qui n’en est que plus bête et gonflée d’importance mais que l’auteur exècre. Le seul défaut d’Emma est de vouloir rêver sa vie, de penser que l’amour est ce qui donnera un sens à sa pâle existence. A sa façon, elle tombe dans le travers de Don Quichotte qui est de croire aux livres qu’elle a lus. C’’est ce défaut d’optique qui fera son malheur. C’est justement sur les mirages de l’Optique qu’est construit Madame Bovary. Flaubert ne peint ses personnages que de biais, par touches impressionnistes et fait perdre de ce fait au lecteur toute chance de se figer dans la compréhension de tel ou tel personnage comme chez Balzac. Il y a une intention perverse à saborder ce qui nous est donné à lire, à faire d’Emma un condensé de traits contradictoires et insolubles. On trouve déjà cette nouveauté quand Stendhal nous présente Sorel vu par Mme de Rénal sous les traits d’une « fille ». Chez Flaubert, il n’est question que d’une casquette que porte Charles en début de roman ou d’attributs semblant insignifiants qui introduisent un personnage ou une situation, dont la banalité pourtant est signifiante. Le lecteur est ainsi assailli d’impressions, mais comme elles sont fugaces, elles ne s’impriment pas en lui. Ainsi, quand on referme Madame Bovary, on s’apitoie d’abord sur elle, quand on n’en moque pas la pitoyable destinée. Puis, sans savoir pourquoi, on passe du sarcasme à l’extrême compassion. A nouveau on balance. Qui est Emma : une femme insatisfaite ou une héroïne de l’amour ? On préfère l’oublier. A tort, car le roman n’existe que parce qu'Emma s’est colletée avec l’inadmissible réalité d’une ville de province, Yonville, celle que nous peint Gustave avec le fiel et la pugnacité qu’on lui connaît. Yonville, c’est une toile d’araignée où grenouillent des notables, le pharmacien Homais en quête infatigable d’honneurs et de médailles, et tous ces autres, des « boutiquiers » dirait Flaubert, Léon, Rodolphe... mus par leurs tristes ambitions ou par leur bon plaisir. Seul Charles échappe, grâce à Emma en fin de livre (« toi, tu es bon ») à la plume vengeresse de Gustave. Car Charles aime son Emma, même s’il l’aime mal et s’il n’est pas de taille à satisfaire son insatiable femme. Ce rendez-vous manqué entre ces deux a quelque chose de poignant, de douloureux qui parle évidemment aux malaimés que nous sommes tous. Mais l’enjeu du roman est ailleurs. Flaubert parle du combat mortel entre Rêve et Réalité, de l’impossibilité de les réconcilier, - que l’un comme l’autre ne peuvent faire bon ménage, qu’il faut donc vivre la réalité, toute médiocre fût-elle, en préservant bien sagement la part de rêve qui est en nous. Pour cela même, il faut aimer Emma, même si ce diable de Gustave à l’instar de lui-même n’a su totalement l’aimer.
Dimanche 3 juillet 2011
Féérie pour une autre fois
Je voudrais revenir sur Céline, qui est pour moi un prosateur incomparable. Christophe Malavoy et son Céline, même pas mort - sorti ces derniers jours en librairie - m’en donne l’occasion. Je n’ai pas lu son livre mais entendu l’auteur sur France Inter parler littérature, ce qui ne peut être boudé. Donc, allons de ce pas dans le sillage de Bardamu. J’ai dit déjà, dans un billet sur Port d’attache, tout le chagrin que j’eus en apprenant les turpitudes de Céline. Je n’y reviendrai pas, sachant qu’on ne peut faire l’impasse sur ses actions ignominieuses pendant l’Occupation. Je m’attacherais aujourd’hui à replacer Céline dans l’histoire littéraire, la nôtre, celle que l’on sait glorieuse et riche de talents. Aujourd’hui plus qu’hier, chacun s’accorde à convenir qu’il a pétri la langue comme personne. L’auteur du Voyage au bout de la nuit et surtout de Mort à crédit est d’abord un styliste. Il a lu Brantôme et nos Moralistes, et connaît par cœur le style Grand Siècle. C’est sans doute pourquoi il a su s’en libérer. On a dit qu’il fut un novateur en introduisant la langue parlée dans un texte écrit. Faux, bien sûr, puisque Rabelais – lui aussi docteur en médecine - avait ouvert la voie. Mais il reste vrai que la gouaille de Céline et son argot de banlieue s’inspirèrent de la santé et de l’outrance débordante de Rabelais dont certains proclament qu’il descendait. Même profusion répétitive, mêmes accumulations, énumérations, entrechocs des mots, même démesure dans le phrasé - sorte de logorrhée hybride d’où naît irrésistiblement le rire chez Rabelais, le bouffon et le grotesque chez Céline. Céline dit lui-même quelque part qu’il n’est à l’aise que « dans le grotesque aux confins de la mort » mais un grotesque qui rappellerait celui halluciné d’un Jérôme Bosch. C’est en effet une constante chez Céline : forcer le trait, en rajouter pour créer le tournis du lecteur. Quand on entre dans son œuvre, on est pris dans ses rets mais comme une mouche dans la toile d’araignée. Tous les portraits qu’on trouve dans Mort à crédit sont outranciers et présentés comme s’ils nous regardaient dans le miroir d’une glace déformante. Tous ont en eux du grand guignol (Guignol’s band) et quelque chose de monstrueux. Tous appartiennent pourtant à notre humanité avec leurs tares et leurs imperfections, que ce soit Robinson dans le Voyage (« Oui, Molly, je suis lâche... »), Gorloge et sa radinerie de boutiquier, de Pereires et sa course aux chimères (Mort à crédit) et tous ces autres qui grouillent et qui grenouillent dans le marigot de la vie, avec pour tout espoir la rançon du bonheur. Céline, c’est un voyage dans les bas-fonds de l’homme, une épopée tragique dans le prolétariat rongé par les cadences infernales, la cruauté des firmes capitalistes, la maladie, la honte d’être pauvre et l’obsession du sexe « qui, lui, ne coûte pas un rond. » C’est une plongée dans nos misères, nos intestines trouilles, nos couardises et nos folies. C’est le désastre de la guerre (Nord, Rigodon, D’un château l’autre) où l’écrivain, traqué et aux abois, en fuite, flanqué du chat Bébert, de sa compagne Lili, de l’acteur Le Vigan dit La Vigue, se fait mémorialiste d’un monde qui s’écroule vu du côté allemand. Céline : l’écrivain du pandémonium, celui qu’il a toujours rêvé de devenir au fond « aux confins de la mort ». Dans son hommage qu’il rend au grand Zola, on croit comprendre qu’il doit beaucoup au maître du Naturalisme. Moi, je le vois plutôt frère en révolte de Jules Vallès, autre insoumis irréductible, non tant par les thèmes abordés (encore que l’un et l’autre parlent du peuple très justement puisqu’ils en viennent) que par la phrase trépidante, la scansion ramassée, la colère exaltée ; Vallès avec des points d’exclamation, Céline avec ses fameux points de suspension. Une même rage les habite, mais Vallès est un Rouge, un communard dans l’âme alors que L.F. Céline incline vers l’anarchisme de droite, pour ne pas dire vers l’hygiénisme racial. Dans tous les cas, je reste convaincu que l’écrivain de Féérie pour une autre fois a « emprunté » sur le plan stylistique au grand et admirable Vallès (dont il faudra parler dans un prochain billet) mais il n’en reste pas moins un écrivain de race – si j’ose ainsi parler – et qu’il s’inscrit dans cette famille d’écrivains tourmentés, soumis à leurs démons que sont Villon, Rimbaud, Lautréamont, Artaud et, hors de France, Pound et Bukowski.
Mardi 7 juin 2011
Il faut commémorer Orwell
A l’origine des grands romans d’Orwell (1984, La ferme des animaux), il y a une vision très politique et acérée couvrant les années 20 et 30, où l’on voit poindre le militant ayant vécu la dèche à Londres finir par s’engager contre Franco et déjà le prophète dénoncer sans appel ce que sera le mal du XXème siècle : le totalitarisme. Il n’est pas seul, c’est vrai, à souligner la gangrène montante. Gide fera le voyage jusqu’en URSS, puis reviendra avec des carnets pleins, dénonçant lui aussi ce qui se trame déjà là-bas. Mais Orwell est le seul (avec Grossman peut-être dans son Vie et Destin vu côté soviétique) à renvoyer nazisme et communisme dos à dos comme deux facettes d’une même pièce. En cela même, et souvent même contre son camp, Orwell a vu bien avant d’autres que le salut humain ne pouvait être communiste, du moins au sens où l’entendait Staline. Relire Orwell me paraît donc une des priorités de notre époque. L’étude de Jacques Lucchesi, intitulée Selon Orwell, nous aide à faire gaillardement le pas car elle aborde avec finesse une des œuvres centrales du XXème siècle. 1984 est sans conteste un livre universel qui dépasse les clivages. Livre-phare, livre-monde dont l’actualité est évidente, livre précieux et capital. Une œuvre à lire de par le monde et quelle que soit la latitude, tant il reflète notre époque et le possible devenir de notre humanité. Je serais prêt à l’imposer de force au programme des lycées si Orwell n’était là pour me tirer l’oreille et me montrer que cet oukase irait a contrario de son message ! Ce que Kafka a défriché dans Le Procès et Le Château, où il était déjà question d’un ordre omniprésent et oppressant, Orwell le prolonge et l’accentue en posant le décor de ce que sera le nouveau siècle. Or justement ce siècle est déjà là ! Nous le vivons et en buvons le fiel jusqu’à la lie ! Jacques Lucchesi dans son étude nous le susurre sans l’air d’y toucher, se tenant à distance respectable pour permettre au lecteur d’entrevoir les claires-voies de saine lucidité qu’il ouvre ici ou là. Qu’on y prenne garde : cette étude est une petite bombe. On voit bien que son auteur pointe les travers de notre monde devenu réellement orwellien. Collant à 1984, nous voilà par lui transportés dans un monde planétaire divisé en blocs, pas si éloigné du nôtre et dont le fonctionnement ressemblerait à s’y méprendre à ce qu’on appelle la mondialisation ! D’emblée, il a aussi raison de mettre l’accent sur l’importance de la langue chez Orwell, à travers le novlangue (travail pugnace, pervers sur le vocabulaire, où comment réduire le champ de la syntaxe, donc de la pensée) et à travers moult slogans qui font froid dans le dos. Là aussi, nous y sommes : la communication est là pour enfanter des formules simplistes qui nous vendront tel candidat, tel produit, et - ce qui glace évidemment le sang - tel mode de vie, telle manière de penser à travers une seule grille de lecture. Rituel commun, quasiment intégré qui voit son pernicieux développement dans le monde angoissant de nos entreprises actuelles (privées comme publiques) par le canal du management. Le management, c’est l’auto-évaluation, le comment-mieux-produire-ou-vendre, quelles que soient les conséquences sur la santé humaine : stress, dépressions, violences contre les autres ou même contre soi. Mais le monde d’Orwell, comme hélas le nôtre, repose sur un ordre huilé et fortement hiérarchisé pas loin d’un univers qui serait concentrationnaire, ersatz d’une société totalitaire comme l’a été l’Allemagne nazie ou l’URSS communiste. Autrement dit, une société organisée ainsi : en bas, beaucoup de « collaborateurs » ayant partie prenante comme autant de rouages, (leur multiplicité diluant du même coup leur responsabilité) ; et en haut le Pouvoir(le Parti), Big Brother, personnage invisible, irréelle, donc jupitérien. On pense au Château où l’arpenteur K n’arrivejamais malgré les tentatives nombreuses qu’il peut faire,et à tous ces messieurs de qui dépend toute chose, bureaucrates lointains aux ordres d’une force tutélaire assimilée hâtivement à Dieu, auquel Kafka se serait nous dit-on référé. Chez Orwell (comme d’ailleurs le Château chez Kafka), Big Brother n’a d’existence propre que parce que les exécutants que nous sommes tous sont les coresponsables du cauchemar social que nous vivons, que nous favorisons quotidiennement en acceptant chacun à sa façon les règles suicidaires du management, l’installation de la Pensée unique, la parcellisation d’une force collective qui, unitaire, renverserait ce monde. C’est le colosse aux pieds d’argile, dont parle La Boétie dans son Discours de la servitude volontaire et qui prétend qu’il suffirait de ne plus soutenir le tyran pour qu’il s’écroule sur lui-même. Dans Orwell, comme ici aujourd’hui, on surveille les déviants. La pensée, l’art, le sexe sont ce qu’il faut traquer et pourchasser, miroir à peine déformant des dérives de nos modèles sociaux post-totalitaires. En cela, l’amour de Winston et de Julia rejoint les grands mythes littéraires, l’amour ne pouvant qu’être brouillon, désobéissant, improductif comme il se doit. On pense au couple Roméo-Juliette qui enfreint les lois de la sainte Famille. Là, c’est le saint Parti qui est l’empêcheur d’aimer en rond. La tragédie se referme inexorablement sur nos deux héros, Winston mourant avec l’image peu reluisante de l’avenir que lui tend O’Brien, un exécutant du régime : « une botte piétinant un visage humain... éternellement. » Un programme pour mille ans aurait dit l’autre. Nous n’y sommes pas encore mais n’en sommes plus très loin. Si nous n’y prenons garde, la machine à broyer la pensée est en marche. Voilà pourquoi lire 1984 est une urgence. On doit à Jacques Lucchesi de nous l’avoir sainement rappelé. Une piqûre de rappel vaut mieux que cent discours ! Mardi 29 mars 2011
LECTEUR
Depuis quelque temps, me voici lecteur dans un collectif associatif dont le but est l’édition d’œuvres théâtrales contemporaines. Lecteur, je le suis depuis toujours, disons depuis ma huitième année. Mais là, me voilà astreint à jauger une œuvre, à peser la qualité d’un texte, à donner un avis favorable ou non sur la pièce lue. Tâche difficile ! Pour ce que j’ai pu noter déjà, il me semble plus facile de discerner ce qu’est un texte de qualité. Un texte, inégal dans sa facture, pêche souvent par un manque de rythme, de ton et de pâte humaine que recherche tout lecteur au fond. A contrario, un bon texte s’affirme comme une évidence. Mais, comme disait Sartre qui n’est pourtant pas de mes auteurs, il faut s’essayer sans cesse à penser contre soi-même, d’autant quand on est... lecteur ! Trop d’à-priori, de réflexes de pensée ou de préjugés nous empêchent d’adhérer à certains textes. Et, souvent parfois, pour une seule raison qui nous paraît être incontestable : parce qu’on n’aime pas ! Bien léger tout ça. Qui nous dit que ce qu’on aime est bon ? Et que tout ce qu’on rejette est exécrable ? Un lecteur, un vrai, doit précisément s’armer de prudente retenue, se méfier de ce qu’il affectionne, qui le fait pleurer ou rire, afin de pouvoir rester ouvert à ce qui lui paraît être étranger à ses valeurs, ses goûts, ses affinités. Fort de cette distance, il pourra sinon aimer, du moins apprécier une œuvre qui le contraindra à discuter avec lui-même. Jeudi 25 novembre 2010
MONTAIGNE, PERIGOURDIN SANS ARTIFICE
De temps en temps, lassé de voir à la télé des histrions qui se disent écrivains et qui le croient parce que certains les canonisent comme tels, je me replonge dans les classiques. Rien ne vaut un classique pour retrouver la pleine santé mentale. Ces derniers jours, j’ai hésité entre Montaigne et Proust. Laissons Proust de côté. Nous le butinerons une autre fois, employant ce vocable à dessein en repensant au narrateur de La Recherche surprenant une rencontre devenue légendaire dans la cour intérieure de l’hôtel de Guermantes. Attachons-nous plutôt au grand Montaigne. Il a plus d’heures de vol, pourrait-on dire. Le Bordelais de notre auteur est paysan, rustique, proche de la vie austère et travailleuse. Le Faubourg Saint Germain est urbain, ampoulé et oisif. Place donc aux Anciens ! Laissons pour un moment Swann de côté ! On a tout dit sur Michel de Montaigne. Le tout et son contraire. Nietzsche l’a adoré et le gardait comme livre de chevet. Merleau-Ponty a invoqué sa « fierté à devoir prendre sa vie en main...puisque rien n’a de sens, si ce n’est que ce sens, il ne le trouvera qu’en elle. » Nul plus que lui n'a célébré la perspicacité à voir, penser, sentir. Quand on tourne ses pages et qu’on écoute sa pensée, on touche au plus concret des choses. Chair et saveur de la pensée, tel est Montaigne. Mais ce qu’il revendique, Michel Eyquem, c’est d’être vu dans son entier, dans sa « façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention ni artifice.» Ah, voilà qui devrait parler à nos vendeurs de soupe d’autofiction ! C’est lui qu’il peint, dit-il. Oui, mais sans artifice. Lui, à savoir l’humain, le trop humain qui est en nous. De l'homme devons-nous donc partir. De sa naïve conformité, de ses humeurs, des ondoiements de ses désirs, de ses maux bien réels. La politesse veut qu'on aborde le personnage selon ces seuls préceptes. D’où cette incise : « Chacun regarde devant soi ; moi, je regarde dedans moi : je n’ai affaire qu’à moi...je me contrôle. » Chacun connaît la postérité des Essais. Ce qu'on sait moins, c'est que logeaient dans le château hérité de son père sa mère et son épouse quand il les écrivit. Certains rapportent que des disputes étaient fréquentes entre mère et belle-fille. On peut imaginer Montaigne tentant de concilier l'inconciliable, puis, de guerre lasse, cherchant refuge dans sa tour. Quand on lit bien Montaigne, on sait que ces ennuis tout domestiques ont pour beaucoup pétri son œuvre. L'hypocondrie et les calculs rénaux dont il souffrait ont inspiré nombre passages des Essais, peut-être les plus beaux. Dans ses moments de lassitude, Montaigne ressasse ses ennuis – déficiences du corps, difficulté à vivre commodément, inconfort récurrent. En fait, derrière ces maux, se niche l'aveu voilé de ne pouvoir mettre bon ordre dans son corps, dans ses pensées, dans son logis. D'où le besoin pressant d'apporter ordre, méthode, pondération au grand chaos du monde. D’où sa grandeur, qui naît de ses faiblesses. Vendredi 3 décembre 2010
POTTER, HOUELLEBECQ, NOTHOMB ET MOI
Le succès en matière littéraire a toujours été - et reste encore pour moi – énigmatique, voire incompréhensible. Comme d’ailleurs l’insuccès. Souvent lié à ce qu’on nomme l’air du temps, un livre prend son essor sur le terreau des interrogations, des doutes et des hantises d’une époque. La nôtre a ses sorciers pour la partie dite littéraire. Apprenti pour Potter, maîtres es savoir-faire pour Amélie Nothomb et Michel Houellebecq. Je n’ai évidemment rien contre leurs ventes en librairie, ni ne dénigre leur succès : ils ont leurs qualités puisque ils ont leur public ! Cet argument est aujourd’hui irréfutable. Autrement dit, tout livre qui ne trouve pas son lectorat est non seulement voué aux oubliettes mais regardé comme n’étant pas un livre. Enfin un livre d’écrivain, il faut le préciser. Avant, un livre était un livre ; aujourd’hui, ce peut être un livre de cuisine ou un livre pour maigrir. Pour m’être frotté à la chose littéraire, je sais pourtant que le succès comme l’insuccès reposent souvent sur un malentendu. Un écrivain est rarement aimé de son vivant pour ce qu’il a écrit. Il est soit le jouet d’une mode, d’un engouement subit et moutonnier, soit l’objet d’un rejet pouvant aller jusqu’à la haine. J’oublie une chose : un écrivain peut être aussi l’objet d’une grande indifférence ! Mais là encore, il faut rester prudent. Il ne faut pas confondre le livre écrit et l’homme. Ce dernier trop souvent étouffe le premier par ce qu’on nomme la médiatisation. Ah, le méchant petit vocable ! En nos temps cathodiques, il est pourtant de bon aloi d’aller vendre son livre sur les plateaux télé. Et là, évidemment, c’est l’enfer pour l’auteur (j’entends celui qui porte réellement une œuvre). Il n’aura ni le temps de parler écriture, ni l’écoute aiguisée que nécessite l’explication d’une œuvre. A ce sujet, - et tant pis si je passe pour un esprit chagrin - je ne crois pas que le travail de l’écrivain soit de passer à la télé, ni même de vendre sa prose ou de l’expliciter, sauf si l’on considère bien sûr qu’un écrivain doit se prêter aux numéros de cirque. Cela dit, soyons clairs : je ne dégoise pas sur le cottage de Joanne où brûle un magnifique feu de bois, ni même sur les bibis et la face grimée de cette chère Amélie, encore moins sur l’œil terne ou l’imper tout fripé de Michel Houellebecq. Loin de moi cette pensée ! Mais je ne peux que constater que tout cela relève du music hall et non de l’écriture. Mercredi 8 décembre 2010
DE L’ECRITURE
Quand on écrit depuis toujours, revient souvent une même question : pourquoi diable écrit-on ? Quel curieux ange du bizarre nous fait choisir la feuille blanche plutôt qu’une sortie en boîte ou une soirée entre copains ? Quel satanique diablotin nous fait bouder la vie réelle pour chevaucher cette chimère qu’est l’écriture ? Après une telle question, qui demeure en suspens, en vient souvent une autre qui hante tout écrivain et qui pourrait se résumer ainsi : suis-je vraiment écrivain ? Vaste interrogation, toute aussi épineuse que le pourquoi écrire. Par là, on se demande qui, hors Montaigne, Rabelais, Racine, Voltaire, Hugo, Vallès, Zola, Proust, Céline (je ne peux tous les citer), peut se prétendre réellement écrivain ? D’ailleurs qui en décide : les autres ou soi ? Hugo s’était promis d’ « être Chateaubriand ou rien ». Zola voulait laisser dans son sillage sa Comédie Humaine ; Proust devenir le Saint-Simon du faubourg Saint Germain et Nabokov dans Ada fait dire à son héros qu’il veut jouer les petits Proust. Fort de tous ces exemples, l’aspirant écrivain a tôt fait de se dire : eux c’est eux, moi je ne suis que moi. Et quand bien même on sent le doux frémissement de l’écriture vous frôler de ses ailes, ces écrasants aïeux vous renvoient dans les cordes. Ce serait même grotesque de se hausser du col. La postérité joue des tours à qui flirte avec elle ! Alors reste l’ultime et lancinant questionnement, (si tant est que l’on ait répondu aux deux premières questions que je viens d’évoquer) : comment, à quel âge, selon quelle circonstance, suite à quelle blessure, quel éblouissement est née en moi la vocation d’écrire ? Quelle influence décisive a concouru à me pousser vers cette porte étroite ? Evidemment, on ne répond jamais à ces questions, ou mal ou à moitié. On ébauche des pistes, des semblants de réponses qui mènent à des impasses ; puis on en vient à des constations, incontestables pour qui écrit. Ecrire, c’est un peu vivre à côté de ses pompes. Par là, j’entends ne jamais vivre simplement, en live comme tout un chacun. C’est toujours vivre en décalage pour engranger, capter et collecter des bribes d’existence, des moments de bonheur, de joie ou de tristesse, des éclats de soleil, des gouttelettes de pluie sur une peau aimée, des rêves, des souvenirs... pour les restituer un jour prochain, sans trop savoir comment ni vraiment à quelle fin, dans ce qui deviendra peut-être un texte ; et de savoir qu’on a tout ça dans sa besace rassure, quand le besoin d’écrire s’affirme. Un peu comme le flambeur qui a plus d’un tour dans son sac et qui, à tout moment, vous sort une carte de sa manche. Y a-t-il aussi chez l’écrivain la tentation naïve d’arrêter le Temps ? Sans doute. Je crois même savoir que l’écrivain se prend parfois au jeu de remonter le temps. « Attendez, nous dit-il. Voyez plutôt comment les choses se sont passées. Non pas comme vous croyez que tout est arrivé, mais comme je vais vous raconter. Lisez-moi, vous verrez ! » Ou encore - ce qui n’est qu’une variante pour suspendre le temps : « Une minute, je vous prie ! Si vous prenez le temps de m’écouter, vous apprendrez à regarder le monde bien autrement ». Si ce n’est pas se réapproprier le cours du temps, ça y ressemble. Ecrire, dit Aragon - qui sait de quoi il parle - n’est pas tant une activité qu’un état permanent. Autrement dit, un écrivain est toujours en état d’écriture sans pour autant écrire concrètement. Quand il regarde, quand il écoute, quand il mord dans un fruit ou même quand il vous parle, il est déjà en train d’écrire. Je le soupçonne même de se donner le luxe de vivre tel amour pour nous le raconter après. Proust, avant Swann, a dû aimer quelqu’un qui n’était pas son genre avec l’arrière pensée d’en nourrir la Recherche. Et, en écho, quand Aurélien rencontra Bérénice, il la trouva franchement laide ; elle lui déplut enfin. On peut penser que l’auteur de Blanche ou l’oubli vécut une même situation avant que de l’écrire. Au vu de ces exemples paradoxaux, je crois qu’il y a de l’apprenti-sorcier chez l’écrivain en devenircar il est prêt à être lui-même l’objet sacrificiel de l’expérience littéraire qu’il mènera un jour. Tout de ce qu’il voit, ressent et vit est matière pour écrire. On dit souvent que l’écrivain est l’affabulateur de sa propre existence. En fait, c’est un illusionniste qui bricole le réel, le dévie de son cours, le magnifie, le rapetisse et souvent l’escamote. Il le modèle comme une glaise pour Golem, ce qui tend à prouver qu’il se prend pour un dieu. Autrement dit, on n’écrit pas sans aspirer à l’air puissant et vivifiant des hauts sommets dont parle fièrement Zarathoustra. Vendredi 17 décembre 2010
Je ne sais pas faire de livres d’ANDRE UGHETTO
Quand on ouvre Je ne sais pas faire de livres d’André Ughetto, on est simplement ébloui. C’est comme une sortie en mer qu’on ferait par temps calme, enfin avec un peu de houle. L’horizon est à nous : Ughetto nous murmure à l’oreille des réflexions profondes, énigmatiques et parfois drôles. Je le soupçonne d’ailleurs d’être de ces marins immobiles au long cours qui vous racontent au coin du feu leurs merveilleux naufrages. Ses poèmes pourtant n’ont rien de débonnaire. Ughetto est racé ; il va au nerf des sensations. Ses poèmes sont épures ; il y a en eux une hiératique beauté. Dans Méditerranée, les vers battent comme des vagues qui sculpteront « de nouvelles Venise ». Il y est dit, dans une formule enchanteresse, que la « patience est dentellière illimitée ». On suit d’autant mieux le poète qu’il est lui-même fin dentellier. L’énigmatique poème qui suit, Bouteille à la mer, au titre couleur d’Iroise, nous dit combien la mer est nourricière et mère de toute vie. Notre vie est liquide « dès le subconscient ténébreux ». Socles est d’une toute autre eau : il a le souffle des épopées à hautes voilures. Sobre dans sa facture, avec toujours cette hauteur de vue, vaillante et fière, d’où parle le poète, qui embrasse des siècles d’aventures humaines du haut de sa dunette. Château est pure merveille et ensorcellement d’un temps figé. Le poème a parfois la simplicité d’une chanson de Verlaine et la proximité d’un Du Bellay. Signatures est troussé joliment, instant pris sur le vif, croquis rapide et frais. Poignant, cinglant, dénonciateur, sans concessions m’est apparu Loin des piscines d’émeraude. La révolte est patente, en apathie totale, sans pose, avec tous ces errants « que d’aucuns aiment pour leur transparence ». Ajustée, faisant mouche comme le trait d’un archer ; Visage de fleuve, puissant, épique, salutaire, où Laure-Marie apparaît dans la Sorgue nageant entre deux eaux, l’un des plus beaux poèmes du recueil avec Socles et le poème qui clôt l’ouvrage, Locomotion souvenir qui, lui, reprend le ton feutré et murmuré de Bouteille à la mer avec plus d’amplitude comme un chant de passeur. Bref, un festin royal auquel le Phocéen Ughetto nous convie avec un rare tremblé qui n’appartient qu’aux vrais poètes. J’ai d’ailleurs hâte de lire ses Rues de la forêt belle dont il signale la parution dans son introduction. Dimanche 19 décembre 2010
Les dénoy-auteurs ou la jetable-poésie de LIONEL MAZARI
J’ai découvert Lionel Mazari, insoumis prophétique. Lumineux et obscur, hautain, proche, pressant, colérique, rieur, persifleur, badin, ce poète flingueur porte des pains de dynamite, non pas entre les dents comme Pierrot le Fou, mais là, enfouis dans la musette de ses strophes. L’impossible séjour est une somme poétique à lire absolument. Mais le poète ici, las de devoir subir la morgue de poètes-imposteurs qui font la pluie et le beau temps en Poésie, a voulu remettre un peu d’ordre dans « la grande écurie de l’incurie » qu’est la poésie d’aujourd’hui. Dans les trois premiers volets des Dénoy-auteurs ou le jetable-poésie court une sainte colère : celle de constater sans fioritures à quoi en est réduite, hélas, la poésie. Triste, lugubre et intraitable constat. Mazari brandit sa plume vengeresse ; il dézingue franchement ceux qui ont mis main basse sur la Poésie. Comme il a du mordant, il ne fait pas dans le velours ou dans la soie et il a mille fois raison ! Dans sa première salve, L’hiver du poème, il dresse un état des lieux tout à fait calamiteux : la poésie d’aujourd’hui (et depuis un certain temps, disons cinquante ans) est aux mains des imbéciles, des gangsters et margoulins. Le jetable-poésie, c’est ce qui se fait chaque matin avec du papier cadeau en prime. En somme du jetable, du consommable, mais sans la plus minime essence de poésie. Dans la deuxième salve, titrée délicieusement Les Anonymes Amnésiques, les dits poètes reconnus ou dits éditeurs de poésie sont mis bellement au pilori, nommément avec humour et dérision. Volée de bois vert contre la gentry dite poétique qui ne peut sortir intacte de la mémorable fessée ! Les « pères Ubu de l’édition » ont, merdre, mérité cent fois d’être ainsi démasqués ! Enfin, la dernière salve, Poésie sans parole, met en lumière la farce que nous jouent (et que se jouent hélas) de bons poètes parfois en s’engageant dans ce que notre tireur à vue appelle « l’oralité poétique ». Dire ou porter ses propres textes ne va pas de soi, c’est vrai. Ne cédons pas aux mirifiques sirènes de ceux qui « dénaturent leurs voix par leur prise de parole » ! Consolons-nous, nous qui scandons nos textes dans nos têtes : « ni le silence ni l’ombre, dit Mazari, ne sont une punition pour le poète. » Dans ses autres poèmes tirés de L’impossible séjour, on retrouve une colère entière, une rage assumée, plus contenue peut-être, et des accents à la Rictus. Il y a maintes correspondances entre les poèmes de Mazari et les Soliloques du Pauvre. On trouve même ici ou là de cette contrition à la Villon, geignarde et vaguement madrée. Mais d’un Villon qui aurait lu Rimbaud, Apollinaire, Carco, Bruant. J’ai lu dans la préface des Dénoy-auteurs qu’on évoquait Lautréamont. Mazari a ses chants, cela paraît incontestable. Au fait, les dit-il devant un auditoire ? Lundi 27 décembre 2010
JULES VERNE, ECRIVAIN GEOGRAPHE
En cette fin d’année 2010, le sexagénaire que je suis se souvient avec émotion des cadeaux qui lui étaient faits pour le Nouvel An. Et ces cadeaux – cavernes d’Ali Baba - étaient pour l’essentiel des piles de livres. A huit, neuf ans j’eus droit à la Bibliothèque Rouge et Or. Cette collection rassemblait tous les grands de la littérature dite « de jeunesse » – Defoe, London, Stevenson, Cooper - et bien évidemment Jules Verne. Tous de grands auteurs, en version expurgée, mais offerts à l’enfant que j’étais comme des friandises Je salue aujourd’hui tous ces oncles et ces tantes qui m’ont permis d’appareiller vers un ailleurs renouvelé. Que grâce leur soit rendue ! Merveilleux livres et fantastiques auteurs. Je dois à leur compagnonnage d’exception un goût indéfectible pour la lecture et une monomanie têtue pour l’écriture. Ces derniers jours, furetant dans la bibliothèque de mon nonagénaire de père, j’ai mis la main sur Le château des Carpates de Jules Verne. J’ai retrouvé la couverture rouge, fac-similé de ce qu’était celle du grand Hetzel. Moment miraculeux. Celui de retourner le livre entre mes mains, d’en soupeser le poids des mots, d’en respirer la trace d’un temps passé. Celui d’en découvrir les premières lignes pour ne le plus lâcher. La magie de Jules Verne n’est pas dans l’écriture ou dans le style, que je trouve aujourd’hui sans attraits, mais dans son pur génie à nous dépayser, à nous faire voyager avec des malles pleines, des contretemps fluviaux ou ferroviaires, des retrouvailles avec des passagers qu’on a croisés sur un quai de départ, le chapeau d’une dame entraperçu à la fenêtre d’un wagon-lit, laquelle dame prendra vie trois chapitres plus loin, un télégramme inopiné qu’un chasseur porte sur un plateau à notre héros buvant un dry au bar de tel hôtel, bref le génie du mouvement, des destins qui se croisent, des épisodes rocambolesques (et très souvent véraces, donc pouvant être vrais). Car les héros de Verne sont tous des voyageurs : des inventeurs (voyageurs de l’esprit), des génies fous (voyageurs du progrès, de l’aventure technique), des reporters et des explorateurs (voyageurs en quête de scoops et de mondes perdus). Ses héroïnes sont toutes filles ou nièces de savants, d’anthropologues ou même déjà elles-mêmes diplômées en paléontologie. Des impatients et remuants, de ceux qui vont a contrario des Facultés, Académies ou des Sorbonne. Des rêveurs éveillés, mais qui prennent le train, l’avion et le bateau pour traverser un continent, un océan ou même la stratosphère. Verne c’est aussi un géographe qui transporte son lecteur, celui des profondeurs comme celui des côtes découpées, des reliefs escarpés, des fleuves remontés, des volcans et des îles. Il s’inscrit dans le droit fil d’une saine lignée (Defoe, Stevenson dont j’ai déjà parlés) et annonce Jack London, Conrad, Monfreid et même un autre géographe, Gracq, qui lui s’attache aux replis du terrain, aux môles, aux sables, aux vents et à l’hydrographie des lieux qui donnent au Rivage des Syrtes un cousinage lointain avec L’île mystérieuse ou même avec certains passages de Michel Strogoff. Verne, c’est un méridien que l’on vient de passer, c’est l’espace infini où la future navette spatiale de 2001, odyssée de l’espace progresse lentement (métaphore exemplaire de l’aventure humaine), c’est l’océan immense qui livre ses secrets et ouvre ses abysses ; c’est une géographie de paysages naturels, de sources de fleuves inconnus, de cratères oubliés, de rêves et de démons humains. Verne est majeur non tant par la psychologie des caractères, la vraisemblance des situations, la qualité du style que par l’espace qu’il offre à tout lecteur de s’affranchir de toute frontière – et donc de toute barrière mentale. Vendredi 31 décembre 2010
LE SATIRICON DE PETRONE
Il m’arrive de relire les Anciens, soit en voyant ce qui, hélas, encombre nos librairies, soit par hygiène de pensée. Un bon vin se doit de vieillir. Pas trop non plus, au risque d’être imbuvable, comme il arrive parfois à certains livres du passé. Pétrone s’en tire bien. Je dirais même qu’il reste très actuel. Détaché de sa gangue de classique défraîchi, il a encore du jus. Et son Satiricon que j’ai ouvert ces derniers jours s’est imposé à moi comme une œuvre frivole, au récit lâche, libre, débridé ; sans rime, ni raison (du moins apparemment), vagabondant au gré d’une fantaisie toujours renouvelée et inventive, bref une œuvre moderne. J’ai bien relu : ces seize livres (seize chapitres dont des parties hélas perdues) écrits sous la période paroxystique de Néron, entre conjurations et meurtres, et composés de prose et de vers mélangés, de contes et racontars – de digressions dirait-on aujourd’hui – ces seize livres donc n’ont pas de thème central à proprement parler. C’est bien ce qui fait là la « modernité » de Pétrone. On s’y promène allègrement, sautant d’un lieu à l’autre, d’une maison où l’on se moque de l’éloquence du moment à un autre logis où l’on fait amplement bombance, quand on ne finit pas dans une chambre de lupanar à trois ou plus... Un « roman » déjanté où il est fait état d’aventures singulières, colorées, pittoresques, vécues par des héros mi-gouapes, mi-voyous – d’antihéros pourrait-on dire – que le ridicule même ne semble plus tuer. Pétrone s’amuse à brosser des portraits comme des croquis pris sur le vif, à nous confier le fruit de ses observations – scènes vues ou vécues – à exploiter le merveilleux filon du burlesque parodique, usé ici jusqu’à la corde, à épingler moqueusement discours, clichés ayant cours à l’époque et manies littéraires qui voudraient glorifier avec pompe et grandeur philosophie et poésie et éloquence ! Ni thème, ni trame véritable ne soutiennent le Satiricon. Un ton léger et caricatural (de romans grecs préexistants ?), une verve sans limites lui donnent son élan. Tout se passe en disputes, en réconciliations sur l’oreiller – ou bien ailleurs – en cocufiages, en projets de vengeance, en complots sombrement ourdis pour se finir en rire et en chansons, en libations et galipettes. Hommes, femmes, gitons, tout semble bon pour jouir de l’amour. Pétrone, nous dit Tacite dans ses Annales, n’avait pas la réputation d’un « débauché... mais celle d’un voluptueux raffiné dans son art. » A sa mort, précise-t-il, « il ne voulait entendre que vers badins et poésies légères. » Heureux temps où, même sous la férule d’un empereur dément, pour peu qu’on trouvât fin, profond, gracieux de raconter sans fard les fariboles, fredaines, secrets d’alcôve de ses contemporains, on pouvait vivre d’insouciance ! Heureuse et saine liberté ! Pétrone est vivifiant. Il faut le lire - ou le relire. Sans trop savoir pourquoi - sans doute à cause de la dérive des personnages, j’ai repensé à Accatone de Pasolini. Il m’est venu aussi l’idée que Le Satiricon était l’illustre ancêtre du roman picaresque. Derrière Encolpe, narrateur et héros de sa propre destinée, se cache déjà Gil Blas de Santillane. Mardi 11 janvier 2011
A Jacques Lucchesi *, pour son ouvrage Du monde et du changement
N’étant pas philosophe, j’avancerai en sioux pour rendre compte de mes diverses lectures de votre ouvrage intitulé Du monde et du changement, ou du moins en critique littéraire, autrement dit exonéré de tout esprit spéculatif (carence qui m’arrange bien). Vos Six lettres philosophiques s’inscrivent dans une tradition qui n’a hélas plus cours : celle de l’échange épistolaire cher à nos philosophes des Lumières. Un genre qui incitait lecteurs d’hier comme d’aujourd’hui à s’ébrouer dans le savoir avec plaisir et volupté. Bravo de renouer avec ce genre qui sut allier clarté du style, limpidité de la pensée, réflexion sur le monde ! Ici, nous ne lisons que les missives qu’envoie un philosophe âgé à un jeune homme qui écrit un mémoire, dont nous n’avons qu’un vague écho : lettres précises, affectueuses et débonnaires qui, sous un ton bonhomme, lèvent des lièvres philosophiques. Il y est fait d’abord état dans une première Lettre de ce que d’aucuns nomment l’accélération de l’histoire à une époque, la nôtre, où les apports technologiques ont insufflé une vélocité plus grande à nos actions et à nos vies. Mobilité facile, accès rapide à de nouvelles données et connaissances, donc notre perception du monde ne peut qu’avoir changé. Le monde pour autant vit-il un changement ? Qu’est donc le monde d’abord : « tout ce qui arrive » dixit Wittgenstein ou, comme Wolff le déclare, est-ce « la conscience, comme le langage, (qui) fait monde » ? Par chance, notre capacité d’abstraction nous aide à prendre du recul, à nous représenter le monde. On pense évidemment au grand Schopenhauer, qui est d’ailleurs cité, et à son Monde comme volonté et comme représentation. Pour lui, où commence l’objet finit le sujet. Il apparaît ailleurs, dans une Lettre lumineuse, que notre monde est plus en mouvement qu’en réel changement, le changement ne signifiant pas pour autant un renouveau. Pour les frileux, le modus vivendi serait de « savoir rester assis en repos dans une chambre » et de ne plus bouger. Une autre Lettre, en réponse à une interpellation du jeune homme qui ferraille philosophiquement, nous parle de l’histoire humaine, des évolutions dans nos mœurs et coutumes, et, dans le cadre naturel, de profondes et futures mutations écologiques. Il est noté qu’en Occident l’homme vit relié à des réseaux, informatiques ou satellites, alors qu’il en existe un
Ajouter un commentaire